Chargement dans le
Google Play
Structure de la matière
Énergie : conversions et transferts
Mouvements et interactions
Ondes et signaux
Les états de la matière
Les circuits électriques
Les signaux
Vision et image
L'organisation de la matière dans l'univers
Constitution et transformations de la matière
Lumière, images et couleurs
Les transformations chimiques
Constitution et transformation de la matière
Propriétés physico-chimiques
L'énergie
Affiche tous les sujets
La guerre froide
Le nouveau monde
Les guerres mondiales
Les religions du vième au xvème siècle
La méditerranée de l'antiquité au moyen-age
La france et la république
Nouveaux enjeux et acteurs après la guerre froide
Le xviiième siècle
Le monde depuis 1945
La crise et la montée des régimes totalitaires
Le monde de l'antiquité
Une nouvelle guerre mondiale
Le xixème siècle
La 3ème république
Révolution et restauration
Affiche tous les sujets
Le monde microbien et la santé
Nourrir l'humanité : vers une agriculture durable pour l'humanité ?
Nutrition et organisation des animaux
Le mouvement
Reproduction et comportements sexuels responsables
Corps humain et santé
La cellule unité du vivant
Diversité et stabilité génétique des êtres vivants
Unité et diversité des êtres vivants
Procréation et sexualité humaine
La géologie
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
La génétique
La planète terre, l'environnement et l'action humaine
Affiche tous les sujets
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Comment s'organise la vie politique ?
La croissance économique
Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire ?
Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
La coordination par le marché
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
La monnaie et le financement
Vote et opinion publique
Les sociétés developpées
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Affiche tous les sujets
14/07/2023
508
13
Partager
Enregistrer
Télécharger





- Gargantua Bac OFFICIEL - 1° Exemplier << Mieux vaut de rire que de larmes écrire parce que rire est le propre de l'Homme » (Avis << aux lecteurs >> p.17) → Conception d'un rire caractéristique de l'humanité. Conception d'un rire thérapeutique : le rire est remède contre les souffrances de la vie. C'est la joie qui fait le sens de l'Homme. Le rire apporte la santé, combat la douleur et le chagrin qui rongent l'homme. Selon les critiques, ce passage du texte de Rabelais serait inspiré d'un passage du traité "Les parties des animaux" d'Aristote, dans lequel ce dernier défend l'idée que: "L'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire". Cependant, il est important de noter que la phrase de Rabelais dans le prologue de "Gargantua" ne se limite pas à cette seule influence. Rabelais développe sa propre philosophie du rire et son utilisation dans la littérature et la critique sociale. Alors que la citation d'Aristote souligne la singularité de l'homme en tant qu'animal rieur, Rabelais va plus loin en faisant du rire un moyen d'expression essentiel et en mettant l'accent sur ses aspects libérateurs et satiriques. Rabelais définit donc des valeurs humanistes dès les premières phrases de son œuvre, en rappelant une capacité que seul l'Homme a : le rire....
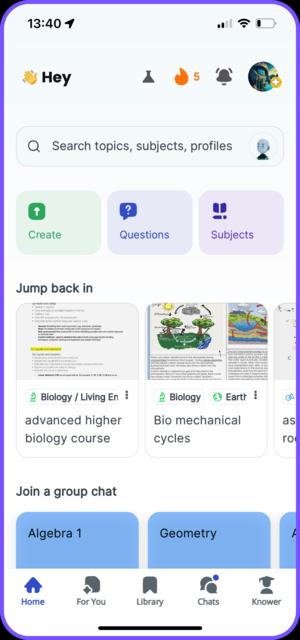

Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
Lola, utilisatrice iOS
Il vaut mieux écrire des choses drôles que des choses tristes, défendre les principes humanistes, qui disent que la joie doit transmettre le savoir. Rabelais promouvra le rire, fidèle aux principes humanistes, qui associe joie et rire à l'apprentissage. Pour R, le rire est une marque d'intelligence et de sociabilité. << Buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux » («< Prologue », p. 19) → Amusement dès le prologue. Rabelais ne s'adresse pas à une élite intellectuelle mais aussi aux lec teurs bons vivants élite incapable de reconnaitre le rire, Alcofribas est un buveur. Alcofribas narrateur provocateur, dès l'ouverture du récit. Comique fondé sur le renversement. Importance du vin et du corps. Rabelais est connu pour son amour de la bonne chère, du vin et des festivités. En s'adressant aux "buveurs très illustres", il reconnaît et célèbre ce penchant pour les plaisirs sensuels. Cela crée une connivence avec les lecteurs qui partagent cet état d'esprit et renforce le lien entre l'auteur et son public. << Rompre l'os et sucer la substantifique moelle. » («< Prologue », p. 20 et 21) → Opposition entre extérieur (grossier) du livre et intérieur (précieux). Voir aussi la métaphore de Socrate et des silènes. Nécessité pour le lecteur de décrypter. Il compare son livre à un os, et qu'il faut tirer la meilleure partie le rire que transmet Rabelais par le biais de Gargantua, les lecteurs doivent apprendre des choses. Plus on lit + on creuse + on découvre la meilleure partie. Il faut ronger pour atteindre la « substantifique moelle ». Métaphore de l'os et de la moelle: Rabelais utilise une métaphore osseuse pour représenter le contenu de son livre. L'os symbolise ici la structure, l'enveloppe externe de l'œuvre, tandis que la substantifique moelle représente l'essence, le contenu profond et nourrissant de l'ouvrage. Cette métaphore évoque l'idée que l'œuvre de Rabelais contient des éléments essentiels et riches en substance qu'il est important d'explorer en profondeur. Encouragement à la lecture attentive : En utilisant l'image de "rompre l'os et sucer la substantifique moelle", Rabelais invite les lecteurs à une lecture attentive et approfondie de son œuvre. Il suggère que le véritable plaisir et la compréhension profonde de son texte ne viennent pas d'une lecture superficielle, mais d'une exploration minutieuse et réfléchie du contenu. Rabelais propose ainsi une approche qui nécessite de s'engager pleinement dans la lecture pour en extraire la quintessence. Recherche de la connaissance et de la vérité : La notion de "substantifique moelle" peut également être interprétée comme la quête de la connaissance, de la sagesse et de la vérité. Rabelais invite les lecteurs à aller au-delà des apparences et des superficies, à s'immerger dans la profondeur de son œuvre afin d'accéder à une compréhension plus complète et enrichissante du monde. Gargantua << sortit par l'oreille gauche » puis cria « à boire, à boire, à boire » (Chapitre 6) → Fantaisie. Comique corporel et de situation. Renversement haut / bas. Importance du vin et de la joie. Absurde car la naissance du géant se fait par l'oreille de sa mère Gargamelle. Rabelais utilise un ton humoristique et exagéré pour décrire les origines de Gargantua. Il souligne la généalogie impressionnante et complexe du personnage. La mention de l'oreille gauche est un détail comique qui ajoute à la fantaisie et à l'absurdité du récit. La phrase "à boire, à boire, à boire" est une expression utilisée par Rabelais dans "Gargantua" pour mettre l'accent sur l'importance de la consommation d'alcool et des festivités dans son récit. Célébration de la joie de vivre: Rabelais était connu pour son amour des plaisirs de la vie, notamment la bonne chère et la convivialité. En utilisant l'expression "à boire, à boire, à boire", Rabelais célèbre l'idée de se réjouir, de se divertir et de profiter des festivités en partageant un verre. Cela reflète son approche de la vie empreinte de joie et de gaieté. Référence à l'ambiance festive : "À boire" est une formule traditionnelle utilisée lors des toasts et des rassemblements festifs pour annoncer que l'on va lever son verre et boire. En répétant cette expression, Rabelais renforce l'idée d'une ambiance festive, de convivialité et de partage. Accentuation du caractère burlesque : Rabelais utilise souvent des formules répétitives et exagérées pour créer des effets comiques et burlesques dans son écriture. En répétant l'expression "à boire" trois fois de suite, il amplifie l'effet humoristique et met en avant l'importance accordée aux festivités et à la consommation d'alcool dans son récit. Critique de l'enseignement scolastique avec « les précepteurs » et « les vieux tousseux »>. (Janotus de Bragmardo Chapitre 19). → Effet comique solennité affectée de la harangue + la trivialité des requêtes. - Un langage faussement savant qui saccage le latin= stigmatise la prétention des théologiens à s'estimer savants. - Références à la farce médiévale= mise en scène costumée (les théologiens sont de mauvais comédiens) et gesticulante des + grotesques. Il dénonce les faux savants comme dans Micromégas(argumente). Rabelais avait une vision critique des précepteurs et des vieux savants de son époque. Il les caricaturait souvent dans ses œuvres, les décrivant de manière humoristique et satirique. Caricature des précepteurs : Rabelais se moquait des précepteurs, qui étaient des professeurs ou des tuteurs chargés de l'éducation des jeunes nobles. Il les décrivait comme des figures pédantes, étroitement attachées aux règles et aux conventions, mais déconnectées des réalités de la vie. Il critiquait leur tendance à privilégier l'apprentissage par cœur et l'enseignement académique formel au détriment d'une éducation plus ouverte, expérimentale et pratique. Ridiculisation des vieux savants : Rabelais ridiculisait également les vieux savants, qu'il appelait parfois les "vieux tousseux". Il se moquait de leur prétention intellectuelle et de leur attachement à des idées dépassées. Il critiquait leur résistance au changement et leur tendance à se complaire dans leur savoir accumulé sans l'appliquer de manière pratique. Rabelais valorisait plutôt une approche basée sur l'expérience, la curiosité et l'ouverture d'esprit. Promotion de l'apprentissage vivant et actif : Rabelais défendait une approche de l'éducation qui favorisait l'expérience directe, l'observation de la nature, la découverte active et l'application des connaissances dans la vie quotidienne. Il pensait que l'apprentissage devait être vivant, stimulant et en constante évolution, plutôt que limité aux confins des livres et des enseignements théoriques. << J'ai inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficace qu'on ait jamais vu ». (Chapitre 13 des torche-culs) Comique scatologique, vocabulaire grossier : contribue à l'effet comique chez le lecteur. On assiste dans un dialogue argumentatif, au récit des expériences entreprises par Gargantua pour trouver le meilleur moyen de se nettoyer. Même si l'argumentation de Gargantua est très formelle, le sujet peut être considéré comme ridicule ce qui peut susciter le rire chez le lecteur. Le but de Rabelais est ici de montrer que l'on peut apprendre tout en s'amusant même les expériences torcheculatifs sont totalement absurdes. Gargantua apprend de façon plaisante. Beaucoup de propos grivois aussi, langage grossier, + familier. Une joie plaisante devant les connaissances, plaisir d'apprendre. Récit scatologique avec beaucoup de néologisme. << Faire la bête à deux dos » (Chapitre 6) Dans le chapitre 6 de "Gargantua", Rabelais utilise l'expression "faire la bête à deux dos", qui est souvent interprétée comme une métaphore comique pour décrire l'acte sexuel. Cette expression s'inscrit dans le style satirique et humoristique de Rabelais, qui se moque des conventions sociales et des tabous. En utilisant un langage vulgaire et érotique, Rabelais remet en question les normes de décence et cherche à provoquer un effet comique. De plus, cette utilisation du langage érotique est liée à la philosophie de Rabelais sur la vie et la nature humaine. Il valorise la jouissance des plaisirs de la vie, y compris la sexualité, et célèbre la vie et le corps humain. Cependant, il est important de noter que le style et le langage de Rabelais peuvent choquer certains lecteurs, et que ses œuvres sont destinées à un public adulte. << Il en devenait fou, niais, tout rêveur et rassoté. »>, (chapitre 15) → Échec de l'éducation scolastique. « Rassoté » néologisme : imbécile. La façon dont ses anciens précepteurs lui enseigné étaient mauvaise, car Gargantua n'apprend rien, le savoir et basé sur du vide. Dans ce passage, Rabelais utilise une langue imagée pour dépeindre l'effet des lectures excessives sur Gargantua. Les termes "fou", "niais", "rêveur" et "rassoté" indiquent que Gargantua devient mentalement déséquilibré, confus et distrait par la surcharge de connaissances qu'il a accumulées. Rabelais critique ainsi l'accumulation excessive de connaissances livresques sans une compréhension réelle et une utilisation pratique de celles-ci. Il suggère que la simple accumulation de connaissances ne suffit pas à développer une sagesse véritable et peut même conduire à une forme d'égarement intellectuel. Ce passage illustre également la critique de Rabelais envers l'enseignement scolastique et l'obsession pour les livres et les connaissances théoriques déconnectées de la réalité. Il souligne l'importance d'une éducation équilibrée qui combine l'expérience pratique, la réflexion personnelle et la sagesse. En somme, Rabelais utilise cette phrase pour critiquer l'excès de lectures sans discernement, qui peut conduire à une perte de clarté d'esprit et à un éloignement de la réalité. << Le savoir hydrate et nourri » (prologue) En utilisant l'image de l'hydratation et de la nourriture, Rabelais suggère que le savoir a une qualité vitale et nourricière, comparable à l'effet de l'eau et de la nourriture sur le corps physique. Il suggère que l'acquisition de connaissances enrichit l'esprit et favorise son épanouissement, tout comme l'eau et la nourriture sont essentielles à la santé et à la croissance du corps. Cette idée est cohérente avec la vision humaniste de Rabelais, qui valorisait l'éducation comme un moyen d'épanouissement individuel et collectif. Il croyait en l'importance de cultiver l'intelligence, la curiosité et la réflexion critique pour développer une vision éclairée du monde. << Des mystères horrifiques, tant en ce qui concerne notre religion que l'état politique et la vie économique »> (Prologue) Rabelais utilise son œuvre pour explorer et remettre en question les conventions sociales et les structures de pouvoir de son temps. En mettant en lumière les mystères et les complexités entourant ces domaines, il encourage une réflexion critique et une remise en question des systèmes en place. Il est important de noter que Rabelais utilise également l'humour et la satire pour aborder ces sujets. Son intention n'est pas seulement de critiquer, mais aussi de divertir et de provoquer une réflexion chez ses lecteurs. Les éléments importants Le but de Rabelais dans ses œuvres, notamment dans "Gargantua" est multifacette et peut être abordé sous différents angles : Critique sociale et politique: Rabelais était un observateur attentif de la société de son époque et de ses travers. Il utilisait l'humour, la satire et la caricature pour critiquer les institutions, les pratiques sociales, les abus de pouvoir et les excès de la société. Il remettait en question les normes établies et dénonçait les inégalités, les injustices et corruption. Critique de l'enseignement et de la pensée traditionnelle : Rabelais s'opposait à l'enseignement scolastique et à l'approche dogmatique qui prévalaient à son époque. Il prônait une éducation plus ouverte, basée sur l'expérience, la curiosité et l'observation du monde. Il critiquait également les préjugés et les superstitions qui limitaient la pensée et l'ouverture d'esprit. Célébration de la vie et de la joie : Rabelais était connu pour son amour des plaisirs de la vie, de la bonne chère, de la boisson et des festivités. Il mettait en avant l'importance de la joie de vivre, de la convivialité et du partage. Il utilisait souvent l'humour et le grotesque pour célébrer les aspects joyeux et burlesques de l'existence. Exploration des connaissances et de la nature humaine : Rabelais était un érudit et un humaniste. Il s'intéressait aux sciences, à la médecine, à l'alchimie et à la philosophie. Ses œuvres regorgent de références et d'allusions à des domaines divers. Il explorait la nature humaine, les passions, les désirs et les contradictions de l'homme. La guerre Dans le roman "Gargantua" de François Rabelais, Picrochole et Grandgousier sont deux personnages importants qui représentent des valeurs et des caractéristiques opposées. Picrochole (Charles Quint) est présenté comme le roi de Lerne, une des villes impliquées dans la guerre picrocholine. Il incarne l'ambition démesurée, l'orgueil et l'arrogance. Picrochole est obsédé par le pouvoir et la conquête, cherchant à étendre son autorité sur d'autres territoires. Il est décrit comme un chef guerrier impitoyable, prêt à mener sa nation dans des conflits destructeurs sans réelle justification. Picrochole est caractérisé par son impulsivité, sa colère facile et son manque de réflexion. En revanche, Grandgousier (François 1er) est le père de Gargantua et le roi de l'Utopie. Il est présenté comme un monarque bienveillant et sage. Grandgousier incarne des valeurs telles que la sagesse, la modération et la justice. Contrairement à Picrochole, Grandgousier cherche à maintenir la paix et l'harmonie dans son royaume. Il est respecté et aimé de son peuple en raison de sa capacité à régler les conflits par la diplomatie plutôt que par la force. Grandgousier représente une figure paternelle protectrice et sage. Ainsi, Picrochole et Grandgousier représentent deux aspects opposés du leadership politique et des valeurs associées. Picrochole incarne l'ambition destructrice, l'avidité de pouvoir et l'agressivité, tandis que Grandgousier symbolise la sagesse, la modération et la bienveillance. À travers ces personnages, Rabelais critique les dirigeants tyranniques et belliqueux, mettant en avant les dangers de l'orgueil et de l'impulsivité dans la gouvernance. Il souligne l'importance d'une gouvernance juste et équilibrée, basée sur la sagesse et la recherche du bien-être de la population. Ces deux personnages représentent également les choix que les individus peuvent faire dans leur propre vie, entre l'ambition démesurée et l'égoïsme d'un côté, et la sagesse et la bienveillance de l'autre. L'abbaye de Thélème Le roman s'achève avec la présentation de l'abbaye de Thélème offerte à frère Jean des Entommeures, en récompense de ses hauts faits d'armes dans la guerre picrocholine. L'abbaye de Thélème n'est pas une abbaye comme les autres. Dans une abbaye traditionnelle, on mène une vie plutôt austère, pauvreté, frugalité, confort spartiate, chasteté, tout ce qui est lié au corps doit être contrôlé pour permettre à l'âme de se rapprocher de Dieu. Chacun est libre d'adhérer ou non à cette vision, mais en tout cas, quand on s'engage dans les ordres, c'est pour la vie. Et cette vie est rythmée par un emploi du temps très précis. A Thélème tout est différent. Déjà, l'abbaye est mixte, les pensionnaires peuvent entrer et sortir de l'édifice comme bon leur semble, ils peuvent exercer le métier de leur choix, toute activité et sont totalement libres de leur emploi du temps. En fait, la devise de l'abbaye est « Fais ce que tu voudras ». Les pensionnaires mènent une vie plutôt sage, plutôt tranquille. Ils passent leur journée à étudier et converser paisiblement. D'ailleurs, une grande partie de l'abbaye est consacrée à d'immenses bibliothèques dans lesquelles on peut lire des ouvrages dans toutes les langues. Ce sont de parfaits humanistes, en somme. Érasme et Montaigne auraient sûrement beaucoup aimé l'abbaye de Thélème. Érasme, humaniste de la Renaissance, prônait l'idée de la liberté individuelle, de la tolérance et de la recherche de la vérité. Il critiquait les excès et les rigidités des institutions religieuses de son époque. Ainsi, il aurait pu trouver dans l'Abbaye de Thélème une représentation littéraire de ses idéaux humanistes. Quant à Montaigne, philosophe et écrivain français, il était également attaché à l'autonomie individuelle et à la diversité des opinions. Montaigne était connu pour son scepticisme et sa volonté d'explorer les différentes facettes de l'expérience humaine. L'idée d'une communauté où chacun est libre de suivre ses propres désirs et aspirations aurait pu résonner avec sa philosophie de vie.