Chargement dans le
Google Play
Mouvements et interactions
Constitution et transformations de la matière
Propriétés physico-chimiques
Les circuits électriques
Énergie : conversions et transferts
Les états de la matière
Structure de la matière
Vision et image
L'organisation de la matière dans l'univers
Les signaux
Lumière, images et couleurs
Ondes et signaux
Les transformations chimiques
Constitution et transformation de la matière
L'énergie
Affiche tous les sujets
Le xviiième siècle
Le monde depuis 1945
Le nouveau monde
Les religions du vième au xvème siècle
Une nouvelle guerre mondiale
La crise et la montée des régimes totalitaires
Les guerres mondiales
La guerre froide
La france et la république
Nouveaux enjeux et acteurs après la guerre froide
La méditerranée de l'antiquité au moyen-age
Le monde de l'antiquité
Le xixème siècle
La 3ème république
Révolution et restauration
Affiche tous les sujets
La génétique
Le mouvement
Le monde microbien et la santé
La géologie
Corps humain et santé
Reproduction et comportements sexuels responsables
Procréation et sexualité humaine
Diversité et stabilité génétique des êtres vivants
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
Nutrition et organisation des animaux
Nourrir l'humanité : vers une agriculture durable pour l'humanité ?
La cellule unité du vivant
Unité et diversité des êtres vivants
La planète terre, l'environnement et l'action humaine
Affiche tous les sujets
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
La coordination par le marché
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
La croissance économique
Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire ?
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment s'organise la vie politique ?
La monnaie et le financement
Vote et opinion publique
Les sociétés developpées
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Affiche tous les sujets
22/12/2022
4433
182
Partager
Enregistrer
Télécharger
































LA LITTÉRATURE D'IDÉES DU XVIème AU XVIIIème SIÈCLE Parcours : ECRIRE ET COMBATTRE POUR L'ÉGALITÉ Groupement de textes sur la condition féminine Texte 1 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges, 1791. Les droits de la femme Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t'a donné le souverain empire' d'opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sag se; parcours la nature dans sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée; et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens; cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'oeuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu...
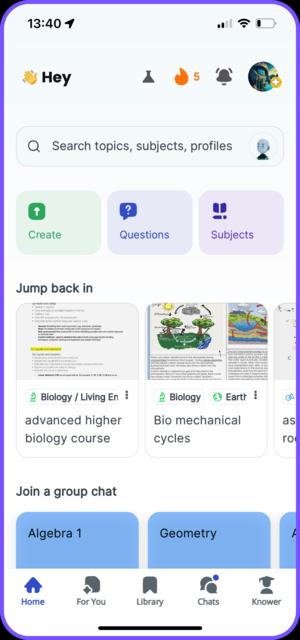

Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
Lola, utilisatrice iOS
toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne A décréter par l'Assemblé nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature Préambule Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous. En conséquence le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnait et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. 1 INTRODUCTION Olympe de Gouges est une autrice du XVIIIème siècle qui a vécu pendant la période révolutionnaire. Politiquement engagée, elle mène des actions politique directe à travers des lettres, des pamphlets, des affiches, des brochures pour dénoncer l'esclavage par exemple ou défendre les droits des femmes. Elle a une carrière de dramaturge, une de ses pièces célèbre est L'esclavage des Noirs. Elle meurt guillotinée en 1793. La déclaration est un texte court, une brochure de quelque pages présentant des textes de différentes natures mais partageant une même visée argumentative → obtenir l'égalité des droits économique et politique entre les hommes et les femmes. L'extrait se situe au tout début de l'œuvre juste après la dédicace à la Reine. Il est constitué de 2 parties distinctes les droits de la femme (s'adresse à l'homme dont elle remet en cause la domination) et le préambule (défense des droits des femmes). Comment l'auteure s'appuie-t-elle sur une stratégie d'attaque et de défense pour rendre compte de l'inégalité entre les hommes et les femmes ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 12: Un discours polémique envers la domination masculine. De la ligne 13 à 27: Une défense des droits des femmes pour la paix de la nation. 1/ Un discours polémique envers la domination masculine Elle interpelle les hommes directement avec l'apostrophe "homme", ce qui crée un effet de surprise. La succession de questions rhétorique est provocatrice, polémique: elle surprend le lecteur en sous-entendant d'emblée qu'il est difficile pour l'homme d'être juste et en remettant en cause la légitimité de sa puissance, elle implique aussi le lecteur et le pousse à refléchir. Le but de l'auteure est en effet d'attaquer la domination masculine «es-tu capable d'être juste ?» 1.1, en interpellant l'homme et en le soumettant à un interrogatoire pour souligner combien cette suprématie opprimante «<opprimer mon sexe» I. 3, et violente <ta force?» I. 3, est illégitime et injuste «qui t'a donné le souverain empire»> I. 2-3. On constate, outre les interrogations, la présence de phrases impératives «Observe», I. 4; <parcours»>, I. 4; « donne-moi », I. 6. Olympe de Gouges se place ainsi dans une position de supériorité vis-à-vis de l'homme : elle apparaît à la fois comme un guide et un juge mettant en évidence ses erreurs, tout en le défiant de s'améliorer «si tu l'oses», I. 6. L'opposition des termes mélioratif comme "grandeur" et "créateur" avec les termes péjoratifs comme "souverain empire d'opprimer mon sexe", "empire tyrannique" et "force" montre que l'idée de la domination de l'homme est contre-nature. Le mot "créateur" renvoie à un principe "être suprême" pas à une religion. Le champ lexical de la nature est présent au début du 2ème paragraphe avec les mots "animaux", "végétaux", "éléments" et "matière organisée". L'auteure n'est pas en accord avec l'attitude des hommes, elle utilise donc du vocabulaire péjoratif ainsi que les champs lexicaux de la monstruosité et de la violence avec les mots "seul", "exception" (qui montre que seul l'homme l'homme cherche à dominer l'autre sexe), "s'est fagoté un principe" (niveau de langue familier), "bizarre, aveugle, boursoufflé (gradation) de sciences et dégénéré", c'est une idée de monstruosité. La nature se caractérise par une organisation égalitaire entre les sexes. Le champ lexical de l'entente et de la paix la définit dès lors: «ils coopèrent» I. 12, « ensemble harmonieux»> I. 12, «chef-d'oeuvre immortel» I. 13. Au contraire, les hommes apparaissent comme une «exception»> 1.14 et se caractérisent par leur violence et leur domination. Les champs lexicaux de la monstruosité et de l'oppression les définissent: «Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré» I. 15 ; «dans l'ignorance la plus crasse» (gradation) 1.16 ; «<commander en despote» I. 17. L'anaphore "partout" est présente deux fois, c'est un procédé 2 d'insistance. L'attitude des hommes est paradoxale dans un siècle marqué par l'intérêt pour les connaissances, les sciences et le progrès. La conclusion à laquelle conduit ce texte est que l'infériorité des femmes n'est pas naturelle, mais est seulement le fait des hommes. Il convient donc que celles-ci récupèrent leurs droits et leur juste place dans la société: «[le sexe féminin] prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité» I. 18-19. 2/ Une défense des droits des femmes pour la paix de la nation Cette partie de la Déclaration est plus solennelle, c'est-à-dire officielle et sérieuse, dans la mesure où Olympe de Gouges s'adresse ici aux membres de l'Assemblée nationale. Comme il s'agit d'une institution officielle, elle utilise un vocabulaire juridique et nettement plus formel: «représentantes de la nation» I. 1 ; «droits naturels, inaliénables et sacrés»> I. 6, << corps social » 1. 8, «institution politique » I. 11, etc. L'énumération «Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation>> I. 1 permet à Olympe de Gouges de se faire la porte-parole des femmes françaises : elle montre que l'auteure entend proposer un texte incarnant les attentes et les désirs de la majorité des femmes. Dans cette énumération elle ne dit pas le mot "épouse" pour exclure totalement l'homme. Selon Olympe de Gouges, les «malheurs publics et la corruption des gouvernements>> I. 4-5 résultent uniquement du manque de considération envers les droits des femmes: si celles-ci se voient reconnaître les droits «naturels, inaliénables et sacrés» 1. 6 auxquels elles ont naturellement droit, les Français et les Françaises pourront être davantage respectés dans leur rôle au sein de la société et parvenir à maintenir intacts «la Constitution, [les] bonnes mœurs et [le] bonheur de tous» 1.13-14. L'enjeu est donc de favoriser la paix et la concorde au sein de la société, ainsi que la mise en place d'un gouvernement vertueux. En regroupant toutes ces informations en une seule phrase, rythmée par la répétition de la conjonction de subordination finale «afin que» et du participe présent "considérant que” qui témoigne de la dimension argumentative et juridique du préambule, Olympe de Gouges met en valeur son raisonnement construit en trois temps (rythme ternaire) ainsi que les trois termes finaux: << Constitution», «bonnes mœurs» et «bonheur de tous ». Dans le dernier paragraphe, le ton est provocateur et ironique, elle dit "le sexe supérieur en beauté" pour reprendre l'argument des hommes, et elle contre leur argument avec le "courage dans les souffrances maternelles" en faisant référence à l'accouchement. CONCLUSION La conclusion à laquelle conduit ce texte est que l'infériorité des femmes n'est pas naturelle, mais est seulement le fait des hommes. Il convient donc que celles-ci récupèrent leurs droits et leur juste place dans la société. Le préambule a une fonction pédagogique, faire comprendre le projet égalitariste de l'auteur avant de le détailler. Il s'agit donc de convaincre du bien-fondé de ce projet. Pour ce faire, Olympe de Gouges s'inscrit explicitement dans la lignée de l'égalitarisme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle imite. Elle souligne en effet l'imperfection de la DDHC de 1789 qui n'a pas tenu ses promesses d'égalité à l'égard des femmes. Une nouvelle Déclaration est donc nécessaire pour lutter contre la corruption de la société. 3 Texte 2: Forme du contrat social de l'homme et de la femme de Olympe de Gouges, 1791. Il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur, dans nos îles. C'est là où la nature frémit d'horreur; c'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies; c'est là surtout où la division et la discorde agitent leurs habitants. Il n'est pas difficile de deviner les instigateurs de ces fermentations incendiaires : il y en a dans le sein même de l'Assemblée nationale : ils allument en Europe le feu qui doit embraser l'Amérique. Les colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères; et méconnaissant les droits de la nature, ils en poursuivent la source jusque dans la plus petite teinte de leur sang. Ces colons inhumains disent : notre sang circule dans leurs veines, mais nous le répandrons tout [entier], s'il le faut, pour assouvir notre cupidité, ou notre aveugle ambition. C'est dans ces lieux les plus près de la nature, que le père méconnaît le fils; sourd aux cris du sang, il en étouffe tous les charmes; que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose? la contraindre avec violence, c'est la rendre terrible, la laisser encore dans les fers, c'est acheminer toutes les calamités vers l'Amérique. Une main divine semble répandre par tout l'apanage de l'homme, la liberté; la loi seule a le droit de réprimer cette liberté, si elle dégénère en licence; mais elle doit être égale pour tous, c'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice. Puisse-t-elle agir de même pour l'État de la France, et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens qui deviennent chaque jour plus effroyables! INTRODUCTION Olympe de Gouges est une autrice du XVIIIème siècle qui a vécu pendant la période révolutionnaire. Politiquement engagée, elle mène des actions politique directe à travers des lettres, des pamphlets, des affiches, des brochures pour dénoncer l'esclavage par exemple ou défendre les droits des femmes. Elle a une carrière de dramaturge, une de ses pièces célèbre est L'esclavage des Noirs. Elle meurt guillotinée en 1793. La première partie du texte est la dénonciation des troubles qui agitent l'Amérique, la deuxième est la dénonciation du traitement inhumain que les colons infligent aux esclaves et la dernière est l'affirmation du juste pouvoir de la loi dans l'exercice de la liberté. Comment Olympe de Gouges dénonce-t-elle l'action terrible des colons esclavagistes et met elle en avant l'action régulatrice de la loi ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 6: Dénonciation de responsables des troubles qui agitent l'Amérique. De la ligne 6 à 13: Dénonciation du traitement inhumain que les colons infligent aux esclaves. De la ligne 13 à 18: Affirmation du juste pouvoir de la loi dans l'exercice de la liberté. 1/ Dénonciation des responsables des troubles qui agitent l'Amérique Olympe de Gouges insiste sur la nécessité avec "il était bien nécessaire que je dise quelques mots sur les troubles que cause, dit-on le décret", elle réagit à l'actualité immédiate et à la colère qu'elle suscite chez les colons. Elle dramatise la situation effroyable et bouleversante des esclaves et le refus des esclavagistes de céder aux idées abolitionnistes avec l'anaphore et le rythme ternaire "c'est 4 là ou" x3, avec la personnification la nature frémit d'horreur" et avec le registre pathétique "la raison et l'humanité n'ont pas touché les âmes endurcies". Olympe de Gouges ne nomme pas les responsables de ces violences pour mettre l'accent sur les effets dévastateurs et criminels de ces positions avec la métaphore filée de l'incendie "fermentations incendiaires", "ils allument le feu" et "embraser" ainsi qu'avec des tournures impersonnelles "il n'est pas difficile" et "il y en a". Enfin, elle utilise des antithèses comme "la nature, la raison et l'humanité" et "la division et la discorde" pour opposer des termes abstraits et mettre en scène deux camps qui s'opposent et cherchent la division. 2/ Dénonciation du traitement inhumain que les colons infligent aux esclaves Olympe de Gouges utilise du vocabulaire moral et péjoratif "despotes", "ces colons", "inhumains", "cupidité", "aveugle ambition" métaphore pour nommer les colons, dénoncer leur comportement et leur appât du gain. Elle condamne aussi les violences et les persécutions perpétrées par les colons avec des verbes qui décrivent les agissements et les pensées des colons "prétendent", "poursuivent", "disent", méconnaissant", "assouvir", "méconnaît", "répandrons", "étouffe", "contraindre laisser"... Avec la répétition de "sang": "la plus petite teinte de leur sang", "notre sang circulent dans leurs veines", sourd aux cris du sang", elle dénonce l'attitude sanguinaire des colons qui persécutent des hommes et leurs familles qui souligne la situation tragique des esclaves qui n'ont ni le droit ni les possibilités de développer leurs qualités humaines. Olympe de Gouges donne un avertissement : la violence et la répression des soulèvements d'esclaves ne fera qu'augmenter la situation avec la question rhétorique "que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose ?" ainsi que le parallélisme de construction et les verbes d'actions violents connotant la peur et la destruction "la contraindre avec violence, la laisser dans les fers" / "la rendre terrible", "acheminer toutes les calamités". Olympe de Gouges condamne fermement le traitement que les colons infligent aux esclaves, d'autant plus qu'ils nient les rapports filiaux et fraternels qui lient les colons aux esclaves. 3/ Affirmation du juste pouvoir de la loi dans l'exercice de la liberté Pour que le rythme porte la conclusion en suivant les préconisations rhétoriques, elle utilise une phrase qui s'amplifie "une main divine semble répandre par tout l'apanage de l'homme, la liberté ; la loi seule a le droit de réprimer cette liberté, si elle dégénère en licence ; mais elle doit être égale pour tous, c'est elle surtout qui doit renfermer l'Assemblée nationale dans son décret, dicté par la prudence et par la justice". Si Olympe de Gouges voit une origine divine dans le déploiement de la liberté à son époque, elle affirme clairement que la loi doit s'appliquer pour l'encadrer donc la protéger avec la synecdoque "une main divine semble répandre" ainsi que tout le vocabulaire juridique et des droits humains : “la loi seule", "le droit de réprimer", "dégénère en licence", "doit être égale", "doit", "Assemblée nationale", "décret", "prudence et justice", "l'apanage des hommes, la liberté", "égale pour tous" et "la justice". Elle formule l'espoir d'une extension du pouvoir bénéfique, régulateur et réparation de la loi à l'échelle du pays avec la phrase exclamative "puisse-t-elle agir de même pour l'Etat de la France, et se rendre aussi attentive sur les nouveaux abus, comme elle l'a été sur les anciens qui deviennent chaque jour plus effroyables !" et les termes comparatifs qui sont des marques d'égalité "de même", "aussi attentive" et "comme". 5 Olympe de Gouges réaffirme sa foi dans la loi et dans son pouvoir de justice et d'égalité. CONCLUSION Olympe de Gouges s'attaque ici sans concession aux colons esclavagistes ; elle dénonce non seulement leurs tentatives et actions violentes pour faire échouer la promulgation de lois en faveur des Noirs, mais aussi leur pratique de l'esclavage qui les conduit à martyriser des esclaves qui sont de leur famille pour les maintenir à leurs service. Pour cette fervente partisane de l'action parlementaire, la loi doit être la source, la garantie et la régulation de la liberté qu'elle appelle de ses vœux. En femme des Lumières, combattante de la Révolution et militante des droits civiques, Olympe de Gouges ne recule devant aucun combat. Si la Déclaration tend à établir l'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'en oublie pas pour autant son autre grand combat, celui qu'elle a mené avec cou age contre l'esclavage, dans ses essais, ses brochures, ses pièces comme Zamore et Mirza, ou aux cotés de Brissot, de Condorcet et de la Société des amis des Noirs, sur les bancs de l'Assemblée, et ce malgrès les pressions des colons et planteurs. L'abbé Grégoire rendra d'ailleurs hommage à son action lorsque l'Assemblée abolira l'esclavage en 1794. 6 Texte 3: La colonie de Marivaux, scène 9 (extrait), 1750. ARTHÉNICE, après avoir toussé et craché.- L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes ;l'insuffisance de leurs lois a beau les punir de les avoir faites à leur tête et sans nous, rien ne les ramène à la justice qu'ils nous doivent, ils ont oublié qu'ils nous la refusent. MADAME SORBIN. - Aussi le monde va, il n'y a qu'à voir. ARTHENICE. - Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas le sens commun, mais tellement décidé que cela va tout seul, et que nous n'en appelons pas nous- mêmes. UNE DES FEMMES. - Hé ! que voulez-vous ? On nous crie dès le berceau : vous n'êtes capables de rien, ne vous mêlez de rien, vous n'êtes bonnes à rien qu'à être sages. On l'a dit à nos mères qui l'ont cru, qui nous le répètent; on a les oreilles rebattues de ces mauvais propos; nous sommes douces, la paresse s'en mêle, on nous mène comme des moutons. MADAME SORBIN. - Oh ! pour moi, je ne suis qu'une femme, mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé cela bon. ARTHÉNICE. - Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorbin, cela est admirable ! MADAME SORBIN. - Cela vient encore de cette moutonnerie. ARTHÉNICE. - Il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable de nos lumières pour avoir adopté ce jargon-là. Qu'on me trouve des hommes qui en disent autant d'eux : cela les passe. Revenons au vrai pourtant : vous n'êtes qu'une femme, dites-vous ? Hé ! que voulez- vous donc être pour être mieux ? MADAME SORBIN. - Eh ! Je m'y tiens, Mesdames, je m'y tiens, c'est nous qui avons le mieux, et je bénis le ciel de m'en avoir fait participante, il m'a comblée d'honneurs, et je lui en rends des grâces nonpareilles. UNE DES FEMMES. -Hélas ! Cela est bien juste. ARTHÉNICE. - Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons, non par orgueil, mais par reconnaissance. INTRODUCTION Après l'échec de l'unique représentation de La Nouvelle Colonie ou La Ligue des femmes en 1729, Marivaux crée une pièce plus courte, en un seul acte composé de 18 scènes, intitulée La Colonie qui sera publiée en décembre 1750 dans la revue Le Mercure de France. Cette comédie met en scène des personnages échoués sur une île. Les femmes se saisissent de cette situation inédite pour proposer un nouvel ordre social en réclamant l'égalité des droits et une plus grande participation à la vie politique. Représentées par Arthénice, 7 femme noble, et Madame Sorbin, femme du peuple, elles se réunissent en assemblée générale. Dans La Colonie, ce ne sont plus les esclaves mais les femmes qui prennent le pouvoir et font entendre leur voix en revendiquant une égalité de droit et une participation active aux affaires de la cité. L'occasion leur est donnée de proposer un nouvel ordre politique en imaginant un gouvernement fondé sur des principes plus égalitaires. Que dénonce Marivaux dans cette scène de comédie ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 16 soutenue par une assemblée de femmes, la noble Arthénice dénonce l'oppression des hommes qui ont su maintenir les femmes dans un état d'infériorité, désormais accepté et assimilé. De la Ligne 17 à 27 Arthénice fait prendre conscience aux femmes et particulièrement à Madame Sorbin - qu'elles ont intériorisé leur état de soumission puis les exhorte à une meilleure reconnaissance de leurs valeurs. 1/ Dénonciation de l'oppression des hommes Dès la didascalie initiale, Arthénice apparaît comme une femme déterminée, qui veut être convaincante: les deux participes passés « toussé » et « craché » montrent qu'elle cherche à imiter les gestes et mimiques propres à l'art oratoire pour donner à ses propos une portée plus solennelle. C'est elle qui parle en premier pour dénoncer l'oppression des hommes. Dans la suite de l'extrait, ses interventions dominent l'échange et font d'elle une combattante qui veut s'imposer dans cette répartition inégale de la parole ses répliques sont souvent plus longues et mieux structurées syntaxiquement que celles de Madame Sorbin ou de l'autre femme. (On remarque d'ailleurs qu'aucune femme de cette assemblée ne cherche à l'interrompre : elle est donc écoutée, respectée dans ses engagements et semble assumer, d'emblée, une fonction de porte-parole.) Elle utilise d'abord un vocabulaire péjoratif « oppression » (1.1), «tyran », (1.2) pour dénoncer le pouvoir des hommes qui est obtenu par la force et la violence. Elle utilise le champ lexical de la justice (« lois »,1.3, «justice »,1.4, pour montrer que les hommes ont injustement instauré des lois pour eux-mêmes, réduisant les femmes à l'état de soumission (1.3). L'argument de la coutume est réfuté par Arthénice au moyen d'une concession à la ligne 2 : « l'oppression [..] pour être si ancienne » (= « même si elle est très ancienne ») si la tyrannie des hommes s'observe historiquement, elle n'a aucune légitimité et doit donc disparaître. Pour pallier ce déséquilibre social et politique, les femmes doivent se mobiliser et faire entendre leur voix car les hommes eux-mêmes ne seront jamais réformateurs de lois écrites à leur avantage. Opposition entre « nous » (les femmes) et « ils » (les hommes) qui met en relief cette situation inégalitaire et conflictuelle. Utilisation de procédés oratoires pour impliquer son auditoire. L'emploi répété du pronom de première personne du pluriel « nous » (I. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 21, 26) et du déterminant possessif « nos » (I. 1 et 17) pour parler au nom des femmes. L'impératif d'exhortation « n'attendons pas » (1.2) qui pousse les femmes à agir. Par son éloquence, Arthénice cherche à susciter l'indignation des femmes par la prise de conscience de leur soumission trop longtemps admise et de l'injustice qu'elles subissent. Il s'agit de les encourager à se révolter et à agir pour changer cet état des choses défavorables aux femmes. 8 Le lexique employé dans la réplique d'une des femmes met en lumière les prétendues incompétences et la nature faussement docile des femmes : la répétition ternaire de la négation «ne ... rien» (I. 12-13), le champ lexical de la parole composé des expressions <<on nous crie» (I. 11), «on l'a dit» (I. 13), «qui nous le répètent» (I. 14), <<mauvais propos» (I. 14) stigmatisent des contre-vérités sur les femmes qui se transmettent éternellement. De plus, les adjectifs «sages» (I. 13), «douces» (1. 15) associées à la comparaison péjorative «comme des moutons» (1. 15) font des femmes des êtres faibles, passifs, incapables de réflexion, se conformant sans cesse aux décisions des hommes. La réplique du personnage est donc traversée par un lexique péjoratif à forte dimension critique. Les femmes sont victimes de préjugés qui remettent en cause leurs capacités intellectuelles et toute volonté d'indépendance, préjugés permis par une éducation plus proche du lavage de cerveau que d'un modèle d'émancipation. Subissant dès le plus jeune âge une forme d'endoctrinement les convaincant de leur incompétence, les femmes intériorisent un discours discriminant et ne peuvent que se résigner à subir la domination des hommes. Arthénice et Mme Sorbin s'opposent dans leur façon de s'exprimer. En effet, Arthénice emploie volontiers un lexique abstrait à travers les termes «oppression» (I. 1), «insuffisances des lois» (1.3), «la justice» (1. 4), «l'arrangement des affaires» (I. 7) et privilégie les phrases longues (1. 2-5; 7-8) et une syntaxe complexe. On remarque également l'inversion du sujet dans la phrase interrogative (1.17-19). De plus, elle sait manier l'ironie avec l'antiphrase : «cela est admirable !» (I. 15), ou «Il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable.» (I. 17). Le niveau de langue utilisé est donc soutenu. A contrario, Mme Sorbin ne cesse de répéter les mêmes propos tout en déformant la comparaison initiale d'Arthénice «comme des moutons» (I. 12). En outre, la syntaxe est souvent approximative: «c'est nous qui avons le mieux» (I. 21), «je lui en rends des grâces nonpareilles» (I. 28). Mme Sorbin, femme du peuple, s'exprime donc dans un niveau de langue plus familier, plus relâché. Ainsi, femmes nobles et femmes du peuple se côtoient, parlent certes une langue représentative de leur niveau social, mais revendiquent ensemble les mêmes droits. La scène semble bien abolir toute hiérarchisation de classe pour s'intéresser à un autre rapport de force : celui des relations entre les hommes et les femmes. Les répliques de Mme Sorbin ont par ailleurs une dimension comique. En effet, la reprise approximative de la comparaison «comme des moutons» (I. 12) par les expressions <<le mouton n'a jamais trouvé cela bon» (1.14) et «Cela vient encore de cette moutonnerie>> (1.16) crée un comique de mot qui dénature l'image initiale. De plus, par sa dernière réplique, Mme Sorbin tente de se hisser au niveau d'Arthénice en usant de formules enthousiastes et dynamisantes mais la syntaxe fautive et les louanges inappropriées au «Ciel»> la distinguent de son interlocutrice. 2/ Prise de conscience des femmes de leur état de soumission et exhortation à une meilleure reconnaissance de leurs valeurs Utilisation d'impératifs: « revenons au vrai » (I. 19), emploi du subjonctif à valeur injonctive << Qu'on me trouve des hommes » (I. 18), les interpellations directes comme << dites-vous » (I. 19) et les questions rhétoriques parfois surmontées d'une interjection (1. 19-20) sont les procédés qui tendent à faire d'Arthénice une oratrice efficace, cherchant à agir sur son auditoire féminin. 9 La négation restrictive : « Vous n'êtes qu'une femme » est suivie d'une question rhétorique : « Que voulez-vous donc être pour être mieux ? » Mme Sorbin confirme être contente de son sort : répétition de « je m'y tiens », (1.21) + utilisation du superlatif : « c'est nous qui avons le mieux » qui revendique la supériorité de la condition féminine sur celle des hommes. Elle utilise également des termes mélioratifs à connotation religieuse, pour évoquer sa condition : «je bénis le ciel » (1.22), « il m'a comblée d'honneurs » (L22), « je lui rends des grâce nonpareilles » (1.23). Avec l'impératif « pénétrons-nous » (I. 26), Arthénice pousse les femmes à réfléchir à de reconnaître leur propre valeur. Opposition entre « l'orgueil » (1.26) et « la reconnaissance » dans une sorte d'antithèse : il ne s'agit pas de se mettre en avant pour dominer mais de cesser de se placer en position d'infériorité vis-à-vis des hommes. Les femmes doivent cesser de se dévaluer pour s'affirmer avec fierté et être reconnues pour leurs valeurs : elles doivent faire confiance à leurs propres capacités et compétences. CONCLUSION Ainsi, dès les premières répliques, les femmes, guidées par l'éloquence d'Arthénice, dénoncent les préjugés misogynes dont elles sont victimes depuis trop longtemps. L'échange se poursuit ensuite plus précisément sur l'infériorité intériorisée par les femmes elles-mêmes et la nécessité pour elles d'être convaincues de leur juste valeur. Le personnage d'Arthénice formule des revendications légitimes qui entrent en résonance avec celles des personnages de Marivaux mais aussi d'Olympe de Gouges : l'égalité de droits entre les époux, l'accès au savoir et à une éducation lettrée pour les femmes, le droit d'occuper des charges dans le domaine de l'armée, des finances ou de la justice. Chez Marivaux, le ton de la comédie et les ressorts comiques du langage donnent à ces débats un tour plus enjoué que grave. Pour autant, sous couvert de bons mots et de situations parfois bouffonnes, cette pièce parvient à faire entendre des réclamations légitimes dont Olympe de Gouges se fait elle aussi la porte-parole quelques décennies plus tard. 10 LE THÉÂTRE DU XVIIème AU XXIème SIÈCLE Parcours : CRISE PERSONNELLE, CRISE FAMILIALE Juste la fin du monde Texte 4: Prologue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, 1990. LOUIS - Plus tard, l'année d'après - j'allais mourir à mon tour - j'ai près de trente-quatre ans maintenant et c'est cet âge que je mourrai, l'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt, l'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision - ce que je crois - pour annoncer, dire, lentement, calmement, d'une manière posée - et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ?, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître - peut-être ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir - et paraître pouvoir là encore décider. me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas (trop tard et tant pis), me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. 11 INTRODUCTION Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène, directeur de troupe et dramaturge. Il à écrit une dizaine de pièces (succès posthume) traduites à l'international, dont Le pays lointain, sa dernière pièce, qui est une réécriture amplifiée de Juste la fin du monde. Dans Juste la fin du monde, une pièce parue en 1990, Louis, le personnage principal revient dans sa famille pour annoncer sa maladie et sa mort prochaine. C'est un parallélisme avec la vie de l'auteur mort à 38 ans du sida. Le prologue est situé au tout début de la pièce, juste après la présentation des 5 personnages principaux : Louis, Suzanne, Antoine, Catherine, et la Mère.. En quoi ce prologue annonce-t-il la tragédie à venir ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 3: Annonce de sa mort prochaine De la ligne 4 à 27: Une décision difficile De la ligne 28 à 36: Rester maître de soi 1/ Annonce de sa mort prochaine Nombreux indicateurs temporels : « plus tard », « l'année d'après »>, << maintenant » qui créent un brouillage des repères en évoquant à la fois le futur (confirmé par le futur de l'indicatif « mourrai »), le passé (confirmé par « j'allais mourir » : futur dans le passé) et et le présent de l'énonciation « j'ai ». (dans Le pays lointain, on apprend que l'expression « l'année d'après » renvoie en réalité à l'année suivant la mort de son amant) C'est une pièce qui commence par une prolepse qui annonce des faits qui vont se produire << plus tard » -> rappel de la tragédie grecque et du rôle du chœur qui commente l'action ou anticipe sur les évènements à venir. Une répétition du verbe « mourir » introduit les thèmes de la mort et de la fatalité : la présence de ces nombreux indicateurs temporels donnent l'impression que son temps est compté et révèlent l'implacabilité du destin (cf « mourrai : le mode indicatif exprime la certitude)-> registre tragique. Le vers «l'année d'après », répété 2 fois dans cette 1ère partie va revenir de manière anaphorique encore 3 fois par la suite, de manière presque incantatoire, prophétique (cette anaphore crée d'ailleurs des ruptures de constructions au niveau de la syntaxe appelées « anacoluthes », comme si le discours était parasité, empêché par le poids de cette mort prochaine). 2/ Une décision difficile Le champ lexical du temps: anaphore de « de nombreux mois» et répétition de <<j'attendais », qui exprime une durée, une attente. Une impression d'une immobilité, voire d'une stagnation, d'un blocage : comparaison « comme on ose bouger parfois / à peine »> -> les deux adverbes appuient sur la difficulté à se mettre en mouvement. Les deux négations partielles "ne rien faire », « ne plus savoir » expriment cette difficulté, l'impression d'un personnage en perdition, bloqué dans un temps fermé, un univers clos. L'appréhension et la «peur» que la décision de cette annonce provoque en lui est révélée par la forte présence d'un champ lexical de la mort - qui parcourt tout le texte (périphrase « en avoir fini », « vous détruirai », « sans espoir d'y arriver ») et du danger : << danger extrême », « geste trop violent », « ennemi >>, << risque »). 12 La répétition de « malgré tout » suggère un retournement de situation dans une tentative de reprise en mains de son destin, même s'il se sait condamné (« sans jamais espoir de survivre »), comme tout héros tragique. La métaphore filée du voyage (« retourner », « revenir sur mes pas », « aller sur mes traces »>, << voyage ») évoque à la fois un parcours géographique et symbolise le passage de la vie à la mort, apparaît comme un voyage inversé puisqu'il va remonter dans le temps en retournant dans sa famille (ceci est perceptible dans le choix des vbs «retourner>> et <<revenir>>). Une insistance sur la manière dont il va annoncer la nouvelle à sa famille dans 2 vers très ponctués - ce qui ralentit le débit - alors même qu'il évoque l'importance du calme, de la lenteur, et du « soin » à apporter à la formulation de cet aveu : « annoncer lentement, avec soin, avec soin et précision » /«<lentement, calmement et d'une manière posée»> (on rem ue d'ailleurs que les 2 adverbes et que le GN sont redondants)-> sorte de scène de théâtre dans le théâtre où Louis imagine, tel un metteur en scène, de quelle façon il convient de dire son texte. Si ce passage permet de dresser le portrait moral de Louis, qui imagine qu'on le considère comme « un homme posé », il permet également de poser l'intrigue de la pièce, ce que révèle le champ lexical de la parole («< annoncer » (X2), « dire »(X2), « messager>>) tout l'enjeu de la pièce est pour Louis, de réussir à dire, à parler. On peut aussi remarquer que Louis a dans cette scène - et dans la pièce-, une sorte de double statut, puisqu'il apparaît à la fois comme un héros tragique et comme un choriste (qui commente l'action dans la tragédie classique); à la fois victime et voix du destin. 3/ Rester maître de soi Cette décision de rester maître de son destin est mise en avant avec le champ lexical de la volonté : répétition de « voulu », « décidé », « décider », « responsable >>, << mon propre maître » Pourtant, le champ lexical de l'illusion montre que ce combat de la volonté contre le destin est perdu d'avance : « paraitre », « peut-être », « paraître pouvoir », « illusion >>; c'est pourquoi Louis ne peut que « donner aux autres (...) l'illusion d'être responsable >>. Cette dernière partie du texte révèle l'intériorité du personnage, peut-être même ses désirs inconscients puisque la phrase mise entre tirets (« - peut-être ce que j'ai tjs voulu, voulu et décidé (...) depuis le plus loin que j'ose me souvenir ») semble nous faire pénétrer dans un monde intérieur plus secret, enfoui. La figure de l'épanorthose (qui consiste à reprendre et corriger ce qui vient d'être dit), comme dans l'expression « ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé », révèle sa recherche de précision et du mot juste pour exprimer son intériorité. La présence des pronoms personnels « eux », « toi », « vous», « elle » et les expressions << aux autres » ou « ceux-là encore que je ne connais pas » montre que son désir de communiquer et de se tourner vers les autres est sans doute à l'origine de cette décision. Un monologue d'une seule phrase, comme d'un seul souffle, présenté sous forme versifiée, très poétique (effets rythmiques dus aux répétitions, reprises, anaphores qui scandent le texte / effets sonores: musicalité, avec par ex « l'année d'après » qui revient comme un refrain ou l'allitération finale en « m»>). 13 CONCLUSION Le prologue présente le personnage principal, le nœud de l'action, la thématique majeure de cette œuvre qui est la difficulté à communiquer. La tonalité tragique avec les thèmes de la maladie, de la mort et de la fatalité. Le style très particulier est caractérisé par le ressassement dans l'écriture et les effets de répétition. Ceci donne une certaine solennité au propos qui devient une écriture poétique. La présence dès le prologue du non-dit, de ce qui vient de l'inconscient et qui peut miner, parasite le discours. Finalement, Louis va partir, à la fin de la pièce, sans avoir réussi à parler. 14 Texte 5: Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, 1990. CATHERINE. - Elle ne te dit rien de mal, tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire, tu ne te rends pas compte, parfois tu es un peu brutal, elle voulait juste te faire remarquer. ANTOINE. - Je suis un peu brutal ? Pourquoi tu dis ça ? Non. Je ne suis pas brutal. Vous êtes terribles, tous, avec moi. LOUIS. - Non, il n'a pas été brutal, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. ANTOINE. - Oh, toi, ça va, «la Bonté même»>! CATHERINE. - Antoine. ANTOINE. - Je n'ai rien, ne me touche pas ! Faites comme vous voulez, je ne voulais rien de mal, je ne voulais rien faire de mal, il faut toujours que je fasse mal, je disais seulement, cela me semblait bien, ce que je voulais juste dire - toi, non plus, ne me touche pas ! - je n'ai rien dit de mal, je disais juste qu'on pouvait l'accompagner, et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse, il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'oser penser cela, arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile ! il fait comme il veut, je ne veux plus rien, je voulais rendre service, mais je me suis trompé, il dit qu'il veut partir et cela va être de ma faute, cela va encore être de ma faute, ce ne peut pas toujours être comme ça, ce n'est pas une chose juste, vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi. cela ne se peut pas, je disais seulement, je voulais seulement dire et ce n'était pas en pensant mal, je disais seulement, 15 je voulais seulement dire. LOUIS. Ne pleure pas. ANTOINE. - Tu me touches : je te tue. LA MÈRE. - Laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. CATHERINE. - Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. LOUIS. Je crois aussi. INTRODUCTION Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène, directeur de troupe et dramaturge. Il à écrit une dizaine de pièces (succès posthume) traduites à l'international, dont Le pays lointain, sa dernière pièce, qui est une réécriture amplifiée de Juste la fin du monde. Dans Juste la fin du monde, une pièce parue en 1990, Louis, le personnage principal revient dans sa famille pour annoncer sa maladie et sa mort prochaine. C'est un parallélisme avec la vie de l'auteur mort à 38 ans du sida. L'extrait est situé à la fin de la pièce juste avant le départ de Louis. Une discussion tendue a eu lieu entre Suzanne et Antoine pour savoir qui ramènera Louis à la gare. Comment cet extrait met-il en scène la crise personnelle d'Antoine ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 9: Le déclenchement du conflit. De la ligne 10 à 19 : La justification d'Antoine. De la ligne 20 à 37: La rivalité fraternelle. 1/ Le déclenchement du conflit La dispute a déjà éclaté entre Antoine et Suzanne au sujet du mot « désagréable ». Pour apaiser les tensions, Catherine se pose en médiatrice de la relation entre Suzanne et Antoine : « Elle ne te dit rien de mal / tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire / tu ne te rends pas compte / parfois tu es un peu brutal / elle voulait juste te faire remarquer >>. On remarque que le discours de Catherine est en chiasme, suivant la structure ABCCBA: << Elle ne te dit rien de mal / tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire / tu ne te rends pas compte / parfois tu es un peu brutal / elle voulait juste te faire remarquer ». Cette construction en chiasme révèle une parole fermée sur elle-même, inefficace, qui ne trouve pas d'issue. Les modalisateurs « un peu », « un peu », «juste » essaient de calmer l'irruption des pulsions dans le débat familial. Catherine est une tierce personne, la seule à ne pas avoir de lien de sang avec les autres personnages. Pourtant, elle ne parvient pas à dépassionner le débat. Sa parole crée presque un effet comique car il y a un décalage entre l'intention de paix et la colère que son discours provoque chez Antoine. On assiste encore une fois à l'inefficacité de la parole qui trompe celui qui l'utilise et dont les intentions ne parviennent pas à atteindre leur destinataire. 16 Antoine rebondit sur le mot «< brutal » sous forme de question (« Je suis un peu brutal ? ») pour développer sa tirade. Ce rebond est d'autant plus ironique que le terme a échappé de la bouche de Catherine dont l'intention initiale était de pacifier les relations. Lagarce nous montre l'essence fondamentalement polémique de la parole. La parole veut unir, réconcilier mais elle divise fatalement car l'incompréhension règne entre les individus. La phrase négative « Non » suivie de la négation totale « ne pas » souligne cette opposition entre les individus : « Non. / Je ne suis pas brutal. >> Antoine par sa fragilité - un seul mot le met hors de lui - se met en position de bouc- émissaire, comme le montre le jeu d'opposition sur les pronoms personnels : « Vous êtes terribles, tous, avec moi ». Le « moi » en fin de proposition place l'individu seul face à la collectivité comme dans la tragédie. L'adjectif « terribles » fait écho à la terreur et la pitié qui selon Aristote sont les deux composantes du tragique. Le tragos, le bouc-émissaire, est seul contre les autres. C'est exactement ce que ressent Antoine qui a l'impression qu'un véritable procès se trame contre lui. 2/ Antoine clame son innocence La phrase de Louis « Non il n'a pas été brutal » reprend le terme « brutal » qui est le chef d'accusation, mais en le niant. Louis joue ici le rôle de l'avocat par le redoublement adverbial de la négation <<Non il n'a pas...». Louis vouvoie aussi Catherine (« je ne comprends pas ce que vous voulez dire »), ce qui met une distance entre les personnages. Antoine n'apprécie pas l'intervention de Louis. A travers l'exclamation (« Oh toi ça va, << la Bonté même » ! »), il donne une interprétation hostile à la bienveillance apparente de la phrase << Non il n'a pas été brutal >>. Comme précédemment avec Catherine, la tentative de Louis d'apaiser les tensions se retourne donc contre lui. Lagarce montre l'échec de la parole qui ne parvient pas à réconcilier les individus mais uniquement à manifester des divergences. Antoine utilise une expression idiomatique (c'est à dire une expression toute faite) << la Bonté même » pour faire ironiquement de Louis l'allégorie de la Bonté. La majuscule à « Bonté » vient renforcer ce statut mythique de l'aîné dont les vertus rayonnent dans la famille. Mais les guillemets soulignent l'ironie de cette louange. Antoine dénonce le jeu théâtral de Louis. Selon lui, Louis mimerait la Bonté pour mieux asseoir sa domination, son calme, sa maîtrise de la situation. On perçoit le mécanisme du conflit qui se déclenche à partir d'un mot - ici le mot << brutal >> - puis contamine tout le discours en soulevant des querelles sans rapport avec l'objet initial du conflit. Le dialogue devient un lieu d'affrontement, une arène. La didascalie interne (« Je n'ai rien, ne me touche pas ») suppose un geste affectueux ou apaisant de Catherine à l'égard d'Antoine. Mais le geste, comme la parole, ne parvient pas à réunir les individus qui restent fatalement enfermés en eux-mêmes. Antoine amorce alors sa défense par une plaidoirie qui rappelle la rhétorique judiciaire. Il clame son innocence par la répétition de l'expression « je ne voulais rien faire de mal »>. Puis il distingue le vouloir et le faire : « je ne voulais rien de mal », « je voulais juste dire », « ce qui me semblait bien »/« fasse mal ». Cette distinction entre l'intention et les actes permet d'affirmer la pureté de son intention et d'utiliser le principe du droit pénal. 17 Le champ lexical de la parole et l'insistance sur le verbe « dire » (« disais seulement >>, << juste dire », « je n'ai rien dit », « je disais ») suggèrent la difficulté des mots à exprimer l'intention. Mais Antoine s'embourbe dans ses propres mots comme le montrent l'antithèse entre les propositions « je ne voulais rien faire de mal » et « il faut toujours que je fasse le mal »>. L'épanorthose (figure de style qui consiste à nuancer et corriger ce qui vient d'être dit) rend sa parole labyrinthique, une parole où la vérité se perd. 3/ La rivalité fraternelle éclate La didascalie interne (« toi, non plus, ne me touche pas ») indique un geste fraternel de la part de Louis, rejeté violemment par Antoine. La syntaxe suggère la séparation des personnages, avec le « toi » désignant Louis, isolé au début d'une phrase hachée par les virgules: « toi, non plus, ne me touche pas !»>. Antoine s'enferme dans son statut de victime et refuse tout soutien. La référence à « la bête curieuse » faite par Antoine rappelle encore une fois le bouc- émissaire, le tragos sacrifié. Il souligne l'injustice de la situation selon lui à travers un vocabulaire moral : « il n'y a rien de mauvais dans ce que j'ai dit, « ce n'est pas bien, ce n'est pas juste >> Puis, par un jeu de pronoms personnels, Antoine oppose le « je « et le « il »> (<< il fait comme il veut, je ne veux plus rien / il dit qu'il veut partir et cela va être de ma faute >>. La structure syntaxique reproduit le face-à-face des deux frères. En désignant son frère à la troisième personne du singulier, Antoine révèle l'hostilité latente qui a toujours existé entre eux. Le champ lexical de la faute (« trompé », « ma faute », « chose juste », « contre moi >>) suggère qu'Antoine ne peut se débarrasser de la faute tragique. Il se laisse alors emprisonner par les mots comme le montre le parallélisme à la fin de sa réplique : « je disais seulement / je voulais seulement dire (..) je disais seulement, / je voulais seulement dire »). Ces répétitions presque farcesques font penser au théâtre de l'absurde de Samuel Beckett, comme la pièce En attendant Godot, où le tragique côtoie le burlesque. La rivalité fraternelle, latente jusque-là, prend soudain une expression directe et saisissante : « Tu me touches : je te tue ». L'asyndète marquée par les deux points («<: ») indique une condition (« Tu me touches ») mais la relation de cause à conséquence exprimée sans conjonction suggère violemment l'imminence du fratricide. La juxtaposition des propositions rend la menace plus pressante. Jean-Luc Lagarce souligne l'échec du langage. La querelle qui se déclenche au départ sur le simple mot «brutal », s'envenime jusqu'au meurtre symbolique que le présent de l'indicatif rend plus réaliste. Ils ne peuvent partager le même espace d'où l'intervention de la Mère « Laisse-le Louis ». L'allitération en «I » vient apaiser la situation. Catherine exhorte Louis à partir : « Je voudrais que vous partiez / Je vous prie de m'excuser, je ne vous veux aucun mal / mais vous devriez partir ». Comme au début de l'extrait, sa réplique est en forme de chiasme, fermée sur elle-même, montrant son incapacité à aller à la rencontre de l'autre. Catherine cherche toujours l'apaisement mais celui-ci ne peut plus se faire que dans la séparation. 18 CONCLUSION Cette scène met en lumière l'échec du langage qui ne parvient pas à réconcilier les individus mais uniquement à renforcer les divergences. À partir d'un simple mot - l'adjectif << brutal » - une querelle se déclenche et s'envenime jusqu'au meurtre fratricide symbolique. Chaque personnage reste enfermé à l'intérieur de lui-même. Cette scène violente constitue le point culminant de la pièce et rend désormais impossible toute annonce de Louis à sa famille, précipitant la chute de la pièce. Louis et Antoine rappellent les fratries tragiques comme Abel et Caïn dans l'ancien testament ou Abel, le fils aîné d'Adam et Ève, tue Caïn son frère cadet. 19 LA POÉSIE DU XIXème AU XXIème SIÈCLE Parcours : MODERNITÉ POÉTIQUE ? Texte 6: Le pont mirabeau de Guillaume Apollinaire, 1912. Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qu'il m'en souvienne La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards l'onde si lasse Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure L'amour s'en va comme cette eau courante L'amour s'en va Comme la vie est lente Et comme l'Espérance est violente Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure Passent les jours et passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau coule la Seine Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure INTRODUCTION Le poème "Le Pont Mirabeau" est un extrait du recueil Alcools publié en 1913 par Guillaume Apollinaire. Apollinaire y fait allusion à sa rupture avec Marie Laurencin, une peintre avec qui il eut une liaison. Le pont Mirabeau qui est pont moderne pour l'époque de l'écriture du poème est situé à Auteuil et fut emprunté par le poète lorsqu'il rentrait de chez Marie Laurencin. Dans ce poème, il évoque l'eau qui est un thème romantique et lyrique qui renvoie au passage du temps et à la fuite de l'amour. Comment Appolinaire transforme-t-il l'échec amoureux en réussite artistique ? 20 MOUVEMENT DU TEXTE Du vers 1 à 6 : la nostalgie d'un amour passé Du vers 7 à 12: La permanence de l'amour Du vers 13 à 18: La souffrance de l'absence Du vers 19 à 22: Le passage du temps et la permanence de la poésie 1/ La nostalgie d'un amour passé Apollinaire ne met pas l'accent sur le pont car le regard est porté "Sous le Pont Mirabeau". C'est un regard descendant et plongeant sur l'eau, métaphore du temps qui passe : "... coule la Seine". L'eau comme métaphore du temps est une référence au philosophe Héraclite pour évoquer le passage du temps : "On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve". Le temps qui passe est un temps destructeur, qui emporte avec lui les amours passées comme le souligne la conjonction de coordination "et" au vers 2 "Et nos amours". Face au constat de cette destruction, Apollinaire cherche à retrouver l'amour passé. Ainsi, le déterminant possessif "Nos amours" recrée une complicité avec la femme aimée. Le pluriel au mot "amours" relève d'un style archaïsant. L'écriture semble ainsi être une tentative de retrouver le souvenir du passé et de retenir le temps qui passe. C'est la solitude qui domine dans cette première strophe. Le verbe "souvenir" relègue l'union avec la femme aimée dans un passé révolu confirmé par l'imparfait "venait toujours". Il y avait bien un vécu commun mais tout cela a disparu. L'impersonnel qui règne avec les deux verbes successifs "Faut-il qu'il m'en souvienne" (v.3) qui soulignent l'effacement des personnes. Le distique (strophe de deux vers) s'apparente à une prière : "Vienne la nuit sonne l'heure". Le champ lexical du temps ("nuit", "l'heure", "jours", "s'en vont") invoque un temps destructeur qui réduit tout à néant. 2/ La permanence de l'amour Pourtant, la fin du vers 6 met en évidence la permanence et la fixité du poète "je demeure". Si l'amoureux s'est effacé, le poète reste, même si on entends le verbe mourir dans "je demeure". Dans le deuxième quatrain, le poète semble rester maître du temps comme le souligne le champ lexical de la permanence : " demeure", "restons", "éternels regards". Les répétitions "Les mains dans les mains restons face à face" créent un effet de circularité qui recrée l'intimité avec Marie Laurencin. Les mots fonctionnent par couple (mains/mains; face/face) dessinant l'image d'un bonheur partagé. Le registre lyrique et l'emploi de la première personne du pluriel: "restons" "nos bras" fait revivre l'amour passé. La métaphore "le pont de nos bras" crée un effet de miroir avec le Pont Mirabeau comme s'il y avait une correspondance entre les sentiments et le paysage. La musicalité des assonances ("mains dans les mains, restons (...) pont (...) l'onde si lasse") renforce l'harmonie apparente de cette scène. 3/ La souffrance de l'absence Quelques dissonances apparaissent néanmoins dans l'harmonie suggérée par ce deuxième quatrain. La tenue lyrique du quatrain est brisée par le deuxième vers "Tandis que sous", très grammatical et circonstanciel, presque prosaïque. Les répétitions mains/mains et face/face rappellent le miroitement des images dans l'eau de la Seine, suggérant la fragilité et la part d'illusion dans cet amour. L'adjectif "lasse" au 21 vers 10 exprime la mélancolie. Ces dissonances sont amplifiées dans le troisième quatrain qui reprend le thème de la solitude et de la mélancolie. Apollinaire poursuit dans ce troisième quatrain la comparaison entre la fuite du temps et la fuite de l'amour ("L'amour s'en va comme cette eau courante"). La répétition de l'expression "L'amour s'en va" aux vers 13 et 14 créé un effet d'écho, comme si le souvenir de Marie Laurencin s'amenuisait. Les phrases elles-mêmes deviennent des échos à travers la paronomase "vie est lente / violente". (La paronomase est le rapprochement de mots aux sonorités semblables). Les mots se transforment, soulignant la douleur du poète. 4/ Le passage du temps et la permanence de la poésie Le champ lexical du temps est omniprésent dans le quatrième quatrain : "passent", "jours", "semaines", "temps passé". Le polyptote (répétition de mots de la même racine) du verbe << passer » (“passent”, “passent”, “passé”) semble faire entendre le tic-tac angoissant d'une horloge. Le passage du temps emporte irrémédiablement avec lui le bonheur passé. La double négation "ni..ni" souligne ainsi l'impossibilité de retenir le temps et les amours passées. On peut même penser que Guillaume Apollinaire joue sur l'homophonie du mot "Seine" qui laisse entendre la "scène" de théâtre : "Sous le pont Mirabeau coule la Seine". Néanmoins, reste la poésie. Le Pont Mirabeau laisse entendre le verbe latin "mirare" qui signifie admirer et l'adjectif français "beau". C'est comme si, derrière la douleur de la séparation, Apollinaire nous appelait à admirer la beauté poétique qui émerge de cette douleur. Le dernier mot de ce poème est d'ailleurs le verbe "je demeure" qui suggère la fixité, la permanence et la stabilité. On peut aussi voir dans ce poème un calligramme. En effet, la disposition des vers et des strophes semble dessiner un pont en arc. Chaque quatrain est un arc du pont, et les distiques (strophe de deux vers) qui se répètent sont l'eau qui passe sous le pont. CONCLUSION Dans "Le Pont Mirabeau", Apollinaire reprend le thème littéraire traditionnel de la fuite du temps. L'image du Pont Mirabeau, symbole de modernité, est une manière de faire le pont entre l'ancien et le moderne, mais aussi entre la littérature et la peinture, et de sublimer l'union perdue entre le poète et la peintre Marie Laurencin. En 1918, Apollinaire publiera les Calligrammes où il réalisera l'union entre le mot et l'image. On peut imaginer un calligramme dans le poème "Le pont Mirabeau". En effet, la disposition des vers et des strophes semble dessiner un pont en arc. Chaque quatrain est un arc du pont, et les distiques (strophe de deux vers) qui se répètent sont l'eau qui passe sous le pont. 22 Texte 7: Le Joujou du pauvre de Charles Baudelaire, 1869. Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusements qui ne soient pas coupables ! Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions d'un sol, - telles que le polichinelle plat mû par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est un sifflet, - et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord ils n'oseront pas prendre ; ils douteront de leur bonheur. Puis leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l'homme. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ces vêtements de campagne si pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse, rendent ces enfants-là si jolis, qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. A côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d'une robe pourpre, et couvert de plumets et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait : De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, pâle, chétif, fuligineux, un de ces marmots-parias dont un œil impartial découvrirait la beauté, si, comme œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère. A travers ces barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant ! Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie elle-même. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, avec des dents d'une égale blancheur. INTRODUCTION Le "Joujou du pauvre" est un poème en prose de Charles Baudelaire extrait du Spleen de Paris, publié de manière posthume en 1869. Charles Baudelaire est un poète majeur du XIXème siècle dont l'œuvre la plus célèbre est le recueil Les Fleurs du Mal. Contrairement au recueil Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris a un caractère en manque d'harmonie : le lecteur passe de la scène de rue au récit allégorique ainsi que de la nouvelle fantastique à la méditation lyrique. L'extrait met en scène deux enfants qui s'observent à travers les barreaux d'une grille, l'un est riche et l'autre pauvre. Quelle est la visée morale de ce poème en prose ? 23 MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 13: Proposition du poète au lecteur. De la ligne 14 à 22: Description d'une scène de confrontation entre deux enfants, l'un riche et l'autre pauvre. De la ligne 23 à 29: Communication entre les deux enfants à travers les barreaux de la grille et fraternité au-delà des différences sociales. 1/ La proposition du poète L'utilisation du pronom personnel "je" montre l'implication personnelle du poète. Il donne un conseil ou fait une proposition au lecteur “je veux donner" à l'aide d'un verbe de volonté. La présence du champ lexical du divertissement "divertissement" et "amusements" est associée immédiatement à l'idée de culpabilité avec l'antithèse "innocent"/"coupable", comme si la légèreté était répréhensible (et renforcée par l'exclamative). Il s'adresse directement au lecteur avec le pronom personnel "vous". Il utilise les temps de l'impératif ("remplissez"/"faites-en hommage") et du futur de l'indicatif ("sortirez"/"rencontrerez"/"n'oseront"/"douteront"/"agripperont"/"s'enfuieront") : le poète propose aux lecteurs (ceux qui ont le temps de "flâner" et qui peuvent acheter des jouets) de distribuer des jouets aux enfants pauvres et d'observer leurs réactions ("vous verrez leurs yeux s'agrandirent démesurément"). Avec le futur, il décrit la scène telle qu'elle va se passer tandis que l'impératif exprime l'ordre, le conseil. Présence d'une énumération de jouets différents, peu chers ("à un sol"); "polichinelle", "forgerons qui battent l'enclume", "cavalier et son cheval". Le poète compare les enfants aux chats ("comme font les chats..."): animalisation de ces enfants qui sont présentés comme sauvages ("ayant appris à se défier de l'homme"). 2/ La description des deux enfants Elle commence par une description de l'enfant riche qui est mis en valeur par le poète à travers des termes mélioratifs: "beau et frais"/"si pleins de coquetterie" (champ lexical de la beauté). Changement de temps: "se tenait" (verbe d'état) à l'imparfait temps de la description. La description du décor : "un vaste jardin"/"la blancheur d'un joli château" connote la richesse et la propreté + métaphore "frappé par le soleil" qui évoque la luminosité, voir la richesse. Le rythme ternaire "le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse" souligne les conditions de vie privilégiées de l'enfant riche. La comparaison "on les croirait faits d'une autre pâte" oppose les enfants riches aux enfants pauvres comme s' ils n'étaient pas de la même nature, comme s' ils n'étaient pas des humains à part entière. Le jouet de l'enfant riche possède les mêmes caractéristiques que son maître : "splendide" + comparaison "aussi frais que son maître". On peut noter le côté ostentatoire de la richesse : cf description du jouet (énumération "verni, doré, vêtu d'une robe pourpre et couvert de plumets et de verroterie"). Pour autant, l'enfant riche se désintéresse de son jouet qui "gisait sur l'herbe", abandonné et regarde celui de l'enfant pauvre. 24 Une description de l'enfant pauvre à l'aide de termes péjoratifs: "sale, chétif, fuligineux" qui connotent le manque d'hygiène, voire la maladie. Les "chardons et orties" montre l'univers hostile dans lequel évolue l'enfant pauvre ; idée que la vie est difficile pour lui. L'enfant pauvre est qualifié de "marmots-parias": utilisation du langage familier et d'un terme qui renvoie à l'exclusion sociale, comme si cet enfant n'avait pas de valeur. Cet enfant est sans doute beau également, mais il faut pouvoir l'imaginer sous la saleté (cf comparaison "comme si l'œil du connaisseur patine de la misère"). Cette "répugnante patine de la misère" est une métaphore qui montre que l'apparence de cet enfant pauvre peut inspirer du dégoût. 3/ La fraternité des enfants au-delà des barrières sociales La métaphore de "barreaux symboliques" exprime les différences sociales, nous invite à décrypter le sens de cette scénette : ces enfants symbolisent "deux mondes" sociaux opposés ; ces oppositions se retrouvent tant au niveau du décor ("château"/"route"), de la description des enfants ("riche"/"pauvre", "propre"/"sale") ou des jouets. Les lieux symboliques "la grande route"/"le château" qui connote le luxe, l'aisance financière, la beauté pour l'un est l'absence de maison, la pauvreté, voir l'errance pour l'autre. Le "joujou" (terme familier et enfantin) du pauvre est présenté dans le dernier paragraphe. Il suscite l'intérêt de l'enfant riche ("examinait avidement") et est mis en valeur par la comparaison "comme un objet rare et inconnu". On apprend à la fin de la phrase que ce joujou est un "rat vivant"; la surprise est soulignée par l'utilisation d'une exclamative et du présentatif "c'était". Ce jouet "vivant" s'oppose au jouet de l'enfant riche qui "gisait" à terre, comme mort, alors que l'enfant pauvre s'amuse avec le rat ("agaçait", "agitait", "secouait"). Cette idée du jouet vivant est renforcée par la dernière phrase du paragraphe ("les parents...avaient tiré le joujou de la vie elle-même"). Dans le dernier paragraphe, les enfants sont mis au même niveau : ils sont réunis dans l'expression "les deux enfants" et par l'adverbe "fraternellement" qui évoque une communion. Le verbe "se riaient l'un à l'autre" montre qu'ils sont réunis dans le monde de l'enfance et du jeu, ce qui traduit une idée de complicité. L'adjectif “égale” annule leurs différences (la couleur blanche symbolise la pureté et l'innocence des enfants). CONCLUSION Le poème en prose Le Joujou du pauvre est basé sur une figure de rhétorique principale, l'antithèse entre l'enfant riche et le pauvre. Nous constatons que l'enfant riche est fasciné par le jouet de l'enfant pauvre (le rat vivant), alors que le riche en possède un beaucoup plus beau. La différence sociale est symbolisée par des barreaux. Ce que montre la thèse de Baudelaire est en faveur d'une égalité sociale. Ce texte est un apologue car il contient une morale implicite infirmant que nous sommes tous égaux. Nous pouvons comparer ce poème à une autre forme d'apologue, les fables, qui délivrent toute une morale implicite ou explicite comme La jeune veuve de La Fontaine qui dénonce l'hypocrisie des femmes avec une fausse tristesse quand elles perdent leur mari. 25 LE ROMAN ET LE RÉCIT DU MOYEN-ÂGE AU XXIème SIÈCLE Parcours : INDIVIDU, MORALE ET SOCIÉTÉ Texte 8: La princesse de Clèves de Mme de La Fayette, 1678. Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté; elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour; elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements; et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. INTRODUCTION Madame de La Fayette de son vrai nom Marie-Madeleine Pioche de La Vergne naît en 1634 dans une famille de petite noblesse. A Paris, elle anime un salon littéraire et côtoie des hommes et des femmes de lettres. Elle est notamment amie avec Madame de Sévigné et La Rochefoucauld. En 1678, elle publie La princesse de Clèves, toujours sous son pseudonyme et remporte un succès immédiat. Elle invente le roman d'analyse psychologique, si bien que La Princesse de Clèves est considéré comme le premier roman moderne français. L'extrait met en scène la première apparition à la cour de Mlle de Chartres. Comment la narratrice rend le portrait de Mile de Chartres attrayant ? MOUVEMENT DU TEXTE De la ligne 1 à 3: Un portrait physique De la ligne 3 à 6: Sa famille De la ligne 6 à 21: Une éducation originale 1/ Portrait physique Phrase 1: La forme impersonnelle créer un effet d'attente accentué par le fait que mademoiselle de Chartres ne soit pas nommée, pas d'indication sur son passé, déterminant indéfini « une beauté ». « alors », adverbe temporel qui marque le caractère soudain de l'événement qu'est cette apparition. 26 insiste sur son apparence La répétition «beauté» et le polyptote: <<belle»> exceptionnelle. La métonymie «une beauté» terme abstrait qui se détache du pluriel «belles personnes » qui fait que cette singularité se détache d'un ensemble vague et stéréotypé. Elle répond aux canons de beauté classiques. Registre épidictique de l'éloge. Les hyperboles : «de tout le monde», «parfaite»: perfection physique + intensif « si » La description indirecte de la cour du roi qui est un lieu exceptionnel de personnes admirablement belles et où on observe et analyse les nouvelles personnes. Le pronom indéfini «on» englobe le lecteur, «on doit croire» présent d'énonciation : pas de doute possible sur le fait qu'elle soit une femme d'exception puisque les nobles ont su déceler le caractère superlatif de cette beauté → personnage idéalisé. 2/ La famille de MIle de Chartres Phrase 2: le pronom personnel « elle » poursuit l'anonymat de Mlle de Chartres. Elle est inscrite dans une lignée : nom commun «maison», nom propre «de Chartres >>. Le Vidame de Chartres étant l'oncle de Mlle de Chartres. Le comparatif de supériorité et l'hyperbole «une des plus grandes héritières de France» met en avant le côté fortuné de cette haute lignée. Phrase 3: Les parents sont présentés avec l'hyperbole «extraordinaires >>, l'énumération à rythme ternaire des qualités de la mère «<le bien, la vertu et le mérite» est une description élogieuse, mais toujours générale et stéréotypée. C'est une forme de perfection morale avec les valeurs essentielles de la femme au XVIIe siècle. 3/ Une éducation originale Phrase 4: Une description de la mère, après la présentation du père. Corrélation entre la mort du père et l'éloignement de la cour, pluriel «plusieurs années». Comme si celle-ci était dangereuse et qu'une protection était nécessaire. Suivi d'un changement de personnage : sa fille. Après le portrait physique, nous avons son éducation pour en faire une femme du monde, une femme honorable. La conjonction de coordination «mais» est un balancement avec «pas seulement» qui est une indication qui va contre les préjugés, la pensée commune, «cultiver son esprit et sa beauté» éducation classique (intellectuelle et physique qualités requises à la cour). «cultiver»> : sous entendu qu'elle en a déjà et on la développe/ «aussi», «donner de la vertu et à la lui rendre aimable» éducation morale qu'il faut apporter à sa fille afin qu'elle s'attache à cette vertu (aimable: radical plus suffixe : digne d'être aimée). La préoccupation de la mère est le mariage de sa fille avec un bon parti. Phrase 5: La narratrice généralise avec «la plupart» et le pluriel «des mères» qui les remet en question, «s'imaginent» qui est un sous entendu d'erreur avec le verbe à la forme impersonnelle «il suffit» critique les systèmes éducatifs des autres mères. La galanterie est ici un terme dépréciatif car il met en avant les aventures amoureuses. Une question de conception d'éducation, ne pas en parler aux jeunes filles afin qu'elles restent dans l'ignorance de l'amour ou leur enseigner par la parole dans un discours didactique, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Phrase 6: Très longue phrase bâtie sur un mode énumératif «elle faisait», «elle lui montrait»>, <<elle lui contait», «elle lui faisait»: liste des actions maternelles afin d'inculquer la vertu et de mettre en garde contre les dangers de l'amour. Imparfaits de répétition. 27 Les antithèses sur l'amour «agréable» / «dangereux» montre que l'amour est une puissance trompeuse qui est attirante, séduisante, donc d'autant plus vicieuse. L'éducation est orientée contre le plaisir personnel, en faveur du respect des codes sociaux. Puis, une description très subjective et péjorative des hommes. Adverbe d'intensité <peu»>, noms dépréciatifs au pluriel «tromperies», «<leur infidélité» au singulier. Les hommes trompent en amour. Redondance du sens de ces éléments. Les conséquences de ces «engagements amoureux» sont les << malheurs domestiques » pour les femmes qui succombent à l'amour alors qu'elles sont mariées. La métaphore «où plongent» est une idée de descente, de chute, de perdition et d'abîme qui montre que l'amour serait source de souffrances. La présentation binaire voir manichéenne (opposition du bien et du mal) «d'un autre côté» met en avant les conséquences d'une vie amoureuse vertueuse « suivait» avec l'opposition du vocabulaire: «tranquillité» (précédé du déterminant exclamatif << quelle >>), <<honnête»>, <<vertu», «éclat», «élévation» ce qui opposent les femme fidèle qui accède au bonheur personnel («tranquillité») et la société («éclat», «élévation >>). Phrase 7: La nouvelle opposition <<mais » signifie qu'aimer la vertu ne suffit plus. Les adjectifs à rôle d'intensification «extrême», «grand >> soulignent la difficulté à rester vertueuse. La «vertu» est le maître mot de son éducation, il est répété trois fois à la fin de cet extrait. L'anaphore <par une et par une» met en avant deux principes de base : I'«<extrême défiance de soi-même» ne pas s'écouter, ne pas se faire confiance, ne pas se laisser porter par ses sentiments ; mise en garde contre soi-même car l'homme est le premier à tendre vers ce qui pourrait lui nuire. Il faut donc être méfiant, prudent, envers ses penchants, ses envies. Présentation d'une vision pessimiste de l'être humain qui est considéré comme toujours prêt à s'illusionner sur lui-même. Le deuxième principe est de «s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme » : le bonheur est ensuite défini par la relative : «qui est d'aimer son mari et d'en être aimée»>. Ces deux principes sont rejetés aujourd'hui. Le polyptote «aimer», «aimée» est une forme active et forme passive. Le domaine amoureux est le seul dans lequel une femme peut s'épanouir avec la formule exclusive du bonheur «ce qui seul» qui est une soumission totale au mari. La métaphore de la femme ligotée au mari «s'attacher à» renforce l'idée de soumission et dépendance de la femme ; volonté de faire d'elle une épouse aimante et fidèle à son époux. CONCLUSION Avec la Princesse de Clèves, Mme de Lafayette propose un personnage féminin complexe. Bien sûr, il s'agit d'un personnage qui appartient à l'aristocratie qui semble avoir tout pour elle, la naissance, la beauté, l'éducation. La princesse de Clèves vit comme dans un conte de fées, elle ne fréquente que des rois et des princes, et elle en épouse meme un. Cependant son parcours est plus douloureux et difficile, et comporte beaucoup d'interrogations sur elle-même. Sans doute finit-elle par choisir effectivement la vertu, mais là encore ses motivations sont complexes, car la peur de n'être plus aimée, la peur d'être abandonnée entrent également en jeu. Cet extrait crée un suspens en ce que cette jeune fille vertueuse intègre une cour qui sera le théâtre de tentations et de mises à l'épreuve. Son éducation lui a donc appris théoriquement à se méfier de ce qu'elle va finalement éprouver adulte avec le comte de Nemours, dans la suite du roman. 28 Texte 9: Indiana de George Sand, 1832. - Daignerez-vous m'apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée et peut-être la nuit ? Ce peut-être apprit à madame Delmare que son absence avait été signalée assez tard. Son courage s'en augmenta. - Non, monsieur, répondit-elle, mon intention n'est pas de vous le dire. Delmare verdit de colère et de surprise. - En vérité, dit-il d'une voix chevrotante, vous espérez me le cacher ? - J'y tiens fort peu, répondit-elle d'un ton glacial. Si je refuse de vous répondre, c'est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. - Je n'en ai pas le droit, mille couleuvres ! Qui donc est le maître ici, de vous ou de moi ? qui donc porte une jupe et doit filer une quenouille ? Prétendez-vous m'ôter la barbe du menton ? Cela vous sied bien, femmelette! - Je sais que je suis l'esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme ; mais sur ma volonté monsieur, vous ne pouvez rien, Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle ! c'est comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide ! - Taisez-vous, sotte et impertinente créature; vos phrases de roman nous ennuient. - Vous pouvez m'imposer silence, mais non m'empêcher de penser. - Orgueil imbécile, morgue de vermisseau ! vous abusez de la pitié qu'on a de vous ! Mais vous verrez bien qu'on peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup de peine. - Je ne vous conseille pas de le tenter, votre repos en souffrirait, votre dignité ny gagnerait rien. - Vous croyez ? dit-il en lui meurtrissant la main entre son index et son pouce. - Je le crois, dit-elle sans changer de visage. CONTEXTE HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE : Face à l'instabilité politique et aux bouleversements économiques du début du XIXème siècle, les romanciers de l'Empire délaissent à leur tour la raison philosophique des Lumières au profit de l'affirmation de l'individu et de sa sensibilité. Le roman sentimental, d'Alfred de Musset ou des débuts de George Sand (Indiana) s'inscrit dans la continuité de cette production romanesque - souvent écrite à la première personne - aux origines du mouvement romantique. En décalage avec la société de l'époque jugée médiocre, le personnage romantique, habité par « le vague des passions », exprime sa révolte et ses doutes, à la recherche d'un idéal inaccessible. Les héroïnes sont souvent au cœur du combat; les écrivains expriment, à travers elles, la force des passions en lutte contre les préjugés, la morale et les lois sociales de leur temps. Les premiers écrits de George Sand reflètent le regard de leur auteur sur le monde qui l'entoure, et annoncent le courant réaliste. Tout en refusant d'être assimilée au personnage féminin d'Indiana, l'écrivaine fait de ce premier roman publié sous un nom de plume un texte engagé et féministe, dans lequel elle revendique, comme dans sa propre vie, la liberté amoureuse et des droits pour la femme du XIXème siècle. 29 PRÉSENTATION DE L'AUTEUR, DE L'OEUVRE ET DU PASSAGE: George Sand - de son vrai nom Aurore Dupin (1804-1876) -, est une romancière française. N'ayant pas eu accès en tant que femme à un quelconque role ploitique, elle fera de toute son oeuvre un combat social et politique pour l'égalité du droit des femmes, la défense des ouvriers et des classes les plus pauvres, l'avènement de la République. En 1832, bravant les codes tacites de l'époque qui interdisaient la carrière littéraire aux femmes, elle signe son premier roman, Indiana, du nom de George Sand. Elle y prend vigoureusement la défense des femmes opprimées dans le mariage tel qu'il est conçu dans le code civil. Elle met en scène une jeune femme, Indiana, élevée à l'île Bourbon (La Réunion) et mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, le colonel Delmare, un mari autoritaire et brutal. L'extrait se situe au moment d'une confrontation tendue entre Indiana et son mari qui l'a fait chercher toute la matinée et qui lui reproche vivement son absence. Comment est mise en scène la révolte d'Indiana dans cet extrait ? MOUVEMENT DU TEXTE : De la ligne 1 à 10: Le refus d'Indiana de répondre à son mari. De la ligne 11 à 20: La remise en cause de l'autorité de son mari et des hommes sur les femmes de manière générale. De la ligne 21 à 28: La victoire d'Indiana. 1/ Le refus d'Indiana de répondre à son mari Le texte s'ouvre par une question du mari qui ne maîtrise pas la situation (« où avez- vous passé la matinée, et peut-être la nuit ? » (1.1-2)) et se trouve donc en position d'infériorité par rapport à sa femme. Indiana va profiter de cet avantage, « Ce peut-être» (1.3) lui révélant que son mari ne sait pas qu'elle est partie toute la nuit, pour affronter la situation. Elle est d'emblée présentée comme un personnage fort, courageux (« Son courage s'en augmenta »). Sa réponse s'ouvre sous le signe du refus, avec une double négation: « non », « mon intention n'est pas de vous le dire ». Dans ce dialogue très proche d'un dialogue théâtral, la phrase « Delmare verdit de colère et de surprise » s'apparente à une didascalie mettant l'accent sur l'effet produit par ce refus initial sur son mari. L'hyperbole « verdit » ainsi que les termes « colère» et « surprise»> révèlent les sentiments contradictoires qui assaillent M. Delmare, comme la notation de sa voix « chevrotante» renvoyant à la fois à son âge mais surtout au fait qu'il soit profondément déstabilisé par la réaction de sa femme. En opposition, la force d'Indiana est de rester impassible et ferme dans sa résolution, ce que révèle son « ton glacial >>. Alors que son mari pense qu'elle veut lui « cacher» (1.7) ce qu'elle a fait, la seconde réplique d'Indiana pousse encore plus loin la provocation en refusant de répondre à son mari uniquement par principe : « je veux vous convaincre que vous n'avez pas le droit de me poser cette question. » (I.10). On retrouve l'utilisation de la forme négative associée au terme « droit » ce qui montre que la rébellion d'Indiana, au-delà de son cas particulier, touche à morale et aux fondements de la société. D'ailleurs, dans la deuxième partie du dialogue, elle va exposer les arguments avec lesquels elle veut « convaincre » son mari. 30 2/ La remise en cause de l'autorité de son mari et des hommes sur les femmes de manière générale Cette remise en cause de son autorité ne va faire qu'accentuer la rage de Delmare dont la première réaction va être l'agressivité, à travers des jurons « mille couleuvres » et insultes « femmelette »>. S'ensuit une série de questions rhétoriques (1.11 à 13) accumulant les clichés dans une tentative désespérée de reprise en main de la situation. Il oppose ainsi l'homme et la femme dans une série d'antithèses avec « maître »>/« femmelette» (dont le suffixe diminutif <<- ette» est péjoratif), « vous »>/« moi », « jupe »>/« barbe » et présente une vision complètement stéréotypée de l'homme dominateur et de la femme réduite aux tâches domestiques << filer une quenouille »>, I.11. Indiana va alors, dans la plus longue réplique de l'extrait, présenter ses arguments. Elle commence par reprendre l'opposition homme/femme développée par son mari pa l'antithèse « maître »>/<< esclave » puis dénoncer « la loi de ce pays », « le droit du plus fort », qui permet aux hommes de dominer leurs épouses. Elle exprime cette toute puissance de l'homme sur la femme grâce aux champs lexicaux de la contrainte physique - voire de la torture avec «<lier mon corps », « garotter mes mains », « gouverner mes actions >> (accumulation ou gradation), puis, plus loin « cachot » (1.18), et « instrument de supplice >> (1.19). La personnification « la société vous le confirme » (1.16) montre que cette situation est due aux droit et aux normes sociales de son époque qui ont institué les lois injustes du mariage. A partir de la conjonction de coordination « mais», elle va opposer aux pouvoirs du mari sa « volonté » (I. 17), contre laquelle il ne peut rien. Cette idée est renforcée par la comparaison « comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide » (1.19-20): cette volonté est donc personnelle et inaccessible : « Dieu seul peut la courber ou la réduire » (1.18). On peut remarquer que cette argumentation clairement structurée utilise plusieurs tours rhétoriques, comme le rythme binaire pour marquer l'opposition entre ce que peut faire le mari et ce qui n'est pas en son pouvoir (« vous pouvez », « vous avez le droit »>/« vous ne pouvez rien »), ou le rythme ternaire dans des gradations, comme «une loi, un cachot, un instrument de supplice », par exemple. 3/ La victoire d'Indiana Tout d'abord, la faiblesse du mari est mise en avant par le fait qu'il ne trouve rien à répondre à sa femme, si ce n'est des insultes : « sotte et impertinente créature»> (1.21). Il lui demande d'ailleurs de se taire en utilisant l'impératif « Taisez-vous», c'est-à-dire en essayant de reprendre son pouvoir sur elle en lui donnant un ordre. Comme précédemment, tout en reconnaissant cette domination « vous pouvez m'imposer le silence », 1.23, Indiana réaffirme l'importance de son autonomie et de sa liberté de penser « mais non m'empêcher de penser »>, 1.24. Les exclamatives qui suivent révèlent la colère de Delmare qui insulte une nouvelle fois sa femme. Dans un parallélisme de construction, il insiste sur l'« orgueil » de sa femme qui pour lui sort de son rôle en se rebellant. On peut remarquer que comme « créature » qui semblait remettre en cause l'humanité de sa femme, il animalise Indiana en la traitant de vermisseau ». La métaphore « dompter » semble poursuivre cette animalisation de son épouse qu'il s'agit pour lui non de comprendre mais de remettre au pas. «< 31 La réponse d'Indiana montre que, sans être nullement impressionnée par les menaces de son mari, c'est lui et non elle qui pourrait en pâtir. « Je ne vous conseille pas de le tenter >> sonne ainsi presque comme une menace sous-entendue, développée par le parallélisme de construction << votre repos en souffrirait, votre dignité n'y qaqnerait rien » (1.27-28). Le futur de l'indicatif, mode de la certitude, ne laisse aucun doute sur les conséquences négatives d'une réaction violente qu'il risquerait de regretter. A bout de nerf, dans une ultime provocation, Delmare fait mal à son épouse en lui meurtrissant la main entre son index et son pouce » (1.29-30). Après les menaces verbales, il en-vient aux violences physiques car il ne parvient pas à impressionner sa femme. La dernière réplique consacre alors la victoire d'Indiana qui confirme une dernière fois ce qu'elle pense << je le crois », 1.31, et retourne sa position de faiblesse en force en ne réagissant pas à la douleur causée par son mari « sans changer de visage ». CONCLUSION La révolte d'Indiana contre son mari mais plus largement contre le mariage et les inégalités hommes-femmes dans la société du XIXème siècle est mise en scène de manière théâtrale dans un dialogue très serré, alternant les questions et les réponses, qu'on pourrait qualifier de joute verbale. Ce passage est situé à un moment-clé de l'intrigue où Indiana joue en quelque sorte sa destinée. Le choix du dialogue direct pour rendre compte de cette confrontation permet de faire ressentir la tension et la violence du débat. C'est aussi un moyen pour G. Sand de faire passer plus directement ses idées par l'intermédiaire de son héroïne. Indiana l'emporte grâce à son calme, son sang-froid et parce que ses arguments sont convaincants et incontestables. Face à elle, son mari perd sa contenance et, n'arrivant pas à la faire taire, en vient à la violence verbale, puis physique, ce qui le discrédite. Ce texte très célèbre peut être considéré comme précurseur du féminisme. Indiana peut être comparée au personnage de Madeleine Forestier, femme libérée qui écrit pour son mari, fume et a des amants dans Bel-Ami de Maupassant. Au XXème siècle, l'œuvre de Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée, publié en 1958, peut également faire écho à la résistance d'Indiana face à la domination masculine. 32