Chargement dans le
Google Play
Mouvements et interactions
Constitution et transformations de la matière
Propriétés physico-chimiques
Les circuits électriques
Énergie : conversions et transferts
Les états de la matière
Structure de la matière
Vision et image
L'organisation de la matière dans l'univers
Les signaux
Lumière, images et couleurs
Ondes et signaux
Les transformations chimiques
Constitution et transformation de la matière
L'énergie
Affiche tous les sujets
Le xviiième siècle
Le monde depuis 1945
Le nouveau monde
Les religions du vième au xvème siècle
Une nouvelle guerre mondiale
La crise et la montée des régimes totalitaires
Les guerres mondiales
La guerre froide
La france et la république
Nouveaux enjeux et acteurs après la guerre froide
La méditerranée de l'antiquité au moyen-age
Le monde de l'antiquité
Le xixème siècle
La 3ème république
Révolution et restauration
Affiche tous les sujets
La génétique
Le mouvement
Le monde microbien et la santé
La géologie
Corps humain et santé
Reproduction et comportements sexuels responsables
Procréation et sexualité humaine
Diversité et stabilité génétique des êtres vivants
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
Nutrition et organisation des animaux
Nourrir l'humanité : vers une agriculture durable pour l'humanité ?
La cellule unité du vivant
Unité et diversité des êtres vivants
La planète terre, l'environnement et l'action humaine
Affiche tous les sujets
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
La coordination par le marché
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
La croissance économique
Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire ?
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment s'organise la vie politique ?
La monnaie et le financement
Vote et opinion publique
Les sociétés developpées
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Affiche tous les sujets
23/12/2021
399
16
Partager
Enregistrer
Télécharger







AXE 2 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : APPROCHE HISTORIQUE ET GEOPOLITIQUE Introduction Le changement climatique est un phénomène qui infecte l'ensemble de la planète : la température moyenne à la surface du globe varie depuis au moins 2 millions d'années. La Terre connait, par cicle, naturellement, une alternance de période glaciaire et de période de réchauffement. Toutefois la période contemporaine marque l'apparition d'un changement climatique de type nouveaux, accéléré par les activités humaines. Ces conséquences sur les sociétés sont variées, tant au niveau économique, politiques, sociale et géopolitique. Les questions environnementales et la gestion de ce réchauffement sont aujourd'hui prises en considération à l'échelle mondiale. En quoi le changement climatique contemporain se distingue-t-il des précédents et quels enjeux géopolitiques soulève-t-il ? LES FLUCTUATIONS CLIMATIQUES ET LEURS EFFETS. L'EVOLUTION DU CLIMAT EN EUROPE DU MOYEN AGE A NOS JOURS. 1) QUELLES SOURCES ET QUELS OUTILS POUR LES HISTORIENS ? • L'histoire du climat est un champ de recherche relativement récent. Emmanuel Leroy-Ladune, Histoire du climat depuis l'an Mil, 1967. . Les historiens travaillent à l'échelle humaine, surtout à partir du Moyen Age car ils disposent de sources plus nombreuses et plus variées connaitre l'évolution de ces températures et des précipitations. • Les sources utilisées par les historiens : les témoignages des pour contemporains, les œuvres d'art, la phénologie (=données quantitatives et répétitives qui concernent les végétaux), des relevés...
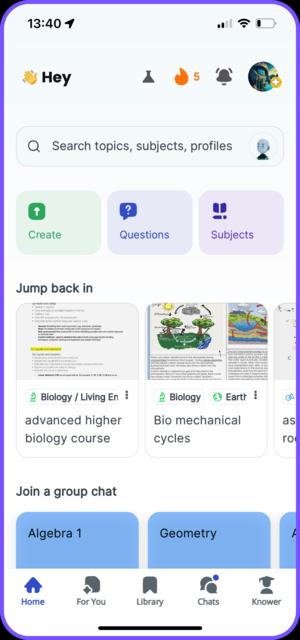

Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
Lola, utilisatrice iOS
de température et de précipitations sur le temps long (à partir du XVIème siècle) + les traces d'événements exceptionnels (échelle de crues), l'évolution des glaciers, la dendrochronologie. 2) L'EVOLUTION DU CLIMAT EN EUROPE DU MOYEN AGE AU MILIEU DU XIXEME SIECLE 2 grandes phases climatiques, aisément indentifiable : Le « petit optimum médiéval », une période caractérisée par des températures plus hautes que la moyenne, d'un maximum de 0,4 degré (entre 800 et 1300); Le « petit âge glaciaire », marqué par des températures plutôt inférieures à la même moyenne, au minimum de 0,5 degré (du XIV° au XIX° siècle). Nombreux accidents laissant apparaître des variations brèves. Qu'est-ce que le « petit optimum » médiéval ? Le « petit optimum » médiéval se caractérise par les étés un peu plus chauds et les hivers en peu plus doux, c'est une période d'agriculture avec un hausse des rendements, le développement de maximum de la vigne en Angleterre, une augmentation de la population en Europe notamment pour les régions situées en Danube. Qu'est-ce que le « Petit Age glaciaire » ? -Des hivers plus longs et plus froids, des étés plus humides. -Des famines plus nombreuses, il y a des récoltes plus irrégulières. -L'avancé des glaciers européens, notamment alpins. Nuance : Le climat a incontestablement un impact sur la vie des hommes, d'autant plus quand les sociétés sont majoritairement agraires, mais il ne faut pas pour autant faire du climat le seul facteur d'explication : les avancés de la recherche historique permettent de se prémunir de tout déterminisme naturel. : 3) LES REFLETS DU CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES SOCIETES. Dans les sociétés d'Ancien Régime, à dominante agraire, les aléas climatiques provoquent des crises frumentaires, qui engendrent une augmentation des prix des denrées de première nécessité, qui peuvent donner naissance à des famines. C'est le cas de celle qui frappe l'Irlande entre 1845 et 1852 et fit de nombreuses victimes : une maladie due à un champignon, le mildiou, s'est répandue dans les champs de pommes de terre, à la faveur d'un été humide et venteux. Les récoltes sont catastrophiques et provoquent une immense famine, qui entraîne des milliers de morts et l'essor de l'émigration vers l'Angleterre et les Etats-Unis. Par ailleurs, le refroidissement du climat fait naître de nombreuses difficultés dans les colonies que les Vikings avaient pu fonder au Groenland. Alimenter les bêtes devint difficile à cause du manque de foin et les fermes ne produisent pas assez pour nourrir l'ensemble de la population, ce qui poussera les Vikings à s'adapter à d'autres formes d'élevage et se tourner vers la chasse, avant de définitivement quitter le Groenland. Mais, à toutes les époques et dans toutes les régions du monde, les hommes ont su s'adapter aux catastrophes provoquées par les modifications du climat. Ainsi, en dépit de conditions climatiques difficiles à l'époque moderne, d'importants progrès sont réalisés dans le domaine agricole et le commerce maritime se développe. Certains historiens y voient une conséquence du « petit âge glaciaire » qui a poussé les Européens à innover. Par ailleurs, les aléas climatiques ont conduit aux premières politiques menées par des autorités publiques pour essayer d'y faire face et pour porter secours aux populations (déblocage de sommes d'argent considérables, constitution de stocks...). À Metz, au XVI° siècle, le grenier de la ville est utilisé comme « banque alimentaire » pour stocker les denrées. La cité développe aussi des productions alternatives à la vigne, trop sujette aux caprices météorologiques. Les variations climatiques peuvent également engendrer des tensions politiques. Certains historiens avancent l'idée que le climat a contribué à faire l'histoire et qu'événements climatiques et historiques sont liés. Ainsi, l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie montre les liens de corrélation entre la crise de subsistance liée aux mauvaises récoltes, et la Fronde des princes face au pouvoir de Mazarin. De même, l'orage de grêle qui a ravagé les récoltes de céréales en 1788 et les 60 jours de gel qui ont frappé Paris lors de l'hiver 1788-1789 et empêché tout trafic fluvial sur la Seine, ont fait passer le prix du pain à 17 sous en 1789, alors qu'un ouvrier gagnait environ 20 sous par jour. Cette disette qui touche la capitale ferait partie des facteurs qui ont poussé la population à se soulever le 14 juillet suivant. Mais ces conditions ne sont pas suffisantes: 1840, par exemple, remplit aussi les conditions agro-climatiques pour devenir une année révolutionnaire, mais il n'en est rien malgré des émeutes de subsistance dans le centre et l'ouest de la France. Les conditions climatiques défavorables sont une cause d'agitation populaire mais celle-ci ne devient révolutionnaire que si elle rencontre un mouvement politique contestant l'ordre établi. Le soulèvement populaire lui apporte alors la force du nombre et la nécessité d'une action immédiate. De ce point de vue, le climat peut amplifier les convulsions historiques mais il ne les crée pas. II. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CONTEMPORAIN, SOURCE DE TENSIONS POUR LES HOMMES ET ENTRE LES HUMAINS. 1) LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CONTEMPORAIN Au 20ème siècle, la température à l'échelle de la planète a augmenté de 0,6 degrés. Et, en 2016, la température moyenne annuelle était de 1,6 degrés supérieurs à celle de l'ère préindustrielle. Le réchauffement observé au 20 -ème siècle est donc bien supérieure aux fluctuations précédentes, de faible amplitude thermique et géographique. De plus, le changement climatique ne se limite pas au seul réchauffement : l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre par industrialisation et le développement des transports bouleverse l'ensemble des équilibres climatiques de la planète. La fonte des glaces, l'amplification des phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation et l'acidification des océans, l'augmentation des pluies et des sécheresses selon les régions ont des conséquences pour les hommes et menacent même parfois leur existence. Le changement climatique contemporain constitue donc une rupture, d'abord parce qu'il est global, ensuite parce qu'il est fort et rapide et qu'il s'accélère encore, enfin parce qu'il est essentiellement d'origine humaine. 2) UN CHANGEMENT CLIMATIQUE QUI AFFECTE LA VIE DES HOMMES Les évènements climatiques extrêmes (canicules, cyclones, sécheresses) voient leur intensité et leur fréquence renforcées, touchant de nombreuses populations. Ces évolutions climatiques mettent aussi en danger certaines pratiques agricoles tandis que l'augmentation de la température des océans menace les ressources halieutiques (ressources de la mer). Ces changements mettent en péril la sécurité alimentaire, déjà fragile pour une partie de l'humanité. ❖ L'élévation du niveau de la mer menace des pays dont les populations et les activités sont fortement concentrées sur les littoraux en raison de la mondialisation : plus de 20% de la population mondiale vit actuellement à moins de 30km des côtes. Les grands deltas asiatiques, aux fortes densités comme au Bangladesh ou occupés par des mégapoles en plein essor comme Shanghai, sont particulièrement menacés. 3- Un changement climatique source de nouveaux enjeux et de nouvelles tensions géopolitiques Diapositives 18 et 19 Le changement climatique global entraîne une multiplication des risques pour les sociétés humaines. Cette pression de plus en plus forte sur les ressources ne fait qu'accroître les conflits d'usage et a des conséquences géopolitiques majeures. Selon certains chercheurs, la déstabilisation politique de la Syrie lors des printemps arabes de 2011 peut être corrélée avec de mauvaises récoltes occasionnées par les sécheresses. Globalement, ce sont les populations dans les pays les moins avancés, comme dans les bidonvilles des métropoles émergentes, qui sont les plus vulnérables et exposées. Dans les pays peu développés et dans les territoires en difficultés économiques, les effets du réchauffement climatiques se cumulent avec les difficultés économiques; la recherche du développement économique, même très polluant, a partout été prioritaire, surtout face aux intérêts environnementaux. Cette dégradation de l'environnement engendre déjà des flux massifs de réfugiés, comme en Afrique et en Océanie, et ils seront probablement 50 millions en 2050, ce qui constitue un problème encore non résolu par le droit international. La déforestation et l'urbanisation multipliant les contacts entre humains et animaux, les zoonoses (maladies se transmettant des animaux vertébrés à l'homme, et vice versa) se développent, comme le coronavirus SARS-COV-2 qui est à l'origine de la pandémie de Covid-19 mettant à l'arrêt les sociétés de nombreux pays. III. LE CLIMAT, UN DEFI ET UN ENJEU DES RELATIONS INTERNATIONALES. 1) UNE PRISE DE CONSCIENCE LENTE ET PROGRESSIVE Point de départ : - années 70 1ere conférence des Nations Unies sur l'environnement (1972) => création du PNUE 80's création du GIEC Connaissance scientifique, objective sur le changement climatique. ☐☐☐ Rapport Meadows Réflexion critique sur le modèle de croissance et ses effets sur les ressources 0 1972 1987 Rapport Bruntland Concept de développement durable 1995 Le 2" rapport du GIEC affirme qu'un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible de Thomme sur le climat». 2014 Le 5º rapport du GIEC detalle les impacts et les risques sur tous continents des activités humaines. Etats moteur : Stockholm Création du Programme des Nations unies pour l'environnement 1992 Rio Adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC) 0 CEE 1997 COP3 Adoption du protocole de Kyoto 2015 COP21 Accord de Paris 2017 Retrait des États-Unis du protocole de Kyoto 2019 «Green Deal» de la Commission européenne visant la neutralité carbone d'ici 2050 1er accord international sur le changement climatique * Le GIEC est un organisme dépendant et affilé de l'ONU. -> il a publié 5 rapports depuis sa création -> il sert de base aux négations internationales pour le climat -> coordonner les politiques des Etats Création des COP annuelles Une prise de conscience lente et progressive Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC et IPCC en anglais) en 1988 à la demande du G7 établir une base scientifique pour la décision future • Synthèse et vérification des données scientifiques collectées dans la littérature Résumé pour décideurs adopté par consensus par délégués des Etats 1er rapport du GIEC adopté en 1990, le 5ème en 2013-14: en 25 ans, forte crédibilité GIEC a établi la réalité du réchauffement et ses impacts ainsi que son origine anthropique > opinion climato-sceptique sans fondement scientifique. Etats appelés à agir dès le premier rapport : début de la négociation sur une convention cadre en février 1991 *1992 -> sommet de la Terre à Rio -> qui ? des chefs d'Etats et des gouvernements, l'ONU. -> quel doc été élaboré ? la CCNUCC (convention cadre des nations unies sur les changements climatiques). Japon AOSIS (association of Création small islands states) du Divergences qui apparaissent déjà CCNUCC Objectif: Limiter la concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère 0 Etats récalcitrants L Les USA Chine ÉLABORATION D'UN RAPPORT DU GIEC S Commande Mesures non contraignantes fo Néanmoins cela reste un accord historique ->1er engagement pour faire les GES (gaz à effet de serre) à l'échelle mondiale -> Développement la coopération scientifique mondiale -> reconnaissance de la responsabilité historique des pays industrialisés du Nord dans le changement climatique. 2) UNE ACTION MULTILATERALE ACCRUE, ENTRE REUSSITES ET ECHECS. 1er exemple : le protocole de Kyoto -L'objectif est de limiter et de baisser l'émission de GES. -> la nouveauté est que les objectives sont chiffrés modestes. -> Mais toujours pas de contraintes + possibilité d'n sortir de l'accord. -Résultats décevants : - il y a des Etats qui ont tenu leurs engagements on, EU), - les principaux pollueurs (USA, Chine, Inde) hors Kyoto. - un texte qui a mis très longtemps à être ratifié (2015- aujourd'hui, il est ratifié par 195 pays). - des critiques : cout trop élevé -> des états qui ont privilégié l'économie au détriment de l'environnement, - sortie de quelques Etats du protocole (USA, Canada), - un marché du carbone déréglementé et trop favorables aux émetteurs de GES, - l'imitation qui ne concerne que les pays développés et par les émergents (Chine...) 2eme exemple: La COP15 à Copenhague (2009) => un échec sur toute la ligne. Tensions entre les gouvernements et leur société civile Tensions très fortes entre les BRICS et les USA. L'UE est marginalisée Impact de la crise économique (2008) Une avancée : la création d'un fonds de 100 milliards dollars/ an (fond vert) pour mettre en œuvre des Politiques environnementales notamment dans les pays en développement. 3eme exemple: la COP21 à Paris (2015) 3) VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE CLIMATIQUE MONDIALE ? Le climat est devenu un sujet en un enjeu des relations internationales, source de rapports de force géopolitique. +-> 70/ 80's pays leader= USA -> 90/00's: UE= élément moteur - contraintes imposés aux entreprises - Natura 2000 - rôle dans les négociations onusiennes -> depuis 10's: poids de plus en plus important de la Chine La conversion de la Chine et sa participation à la gouvernance climatique mondiale c'était pour des considérations économiques. Autre raison, géopolitique : la Chine se veut le porte-voix des pays en développement et il trouve un moyen de s'imposer à l'échelle mondiale comme une puissance majeure mais le problème, c'est que la Chine reste le premier polluant mondial. Une gouvernance qui implique des acteurs de plus en plus nombreux ONU (CCNUCC) États + acteurs institutionnels (UE, AOSIS, C40) ONG FTN Société civile (marches de la jeunesse pour le climat) ➡ Gouvernance qui se veut représentative, inclusive, dans un esprit multilatéral Mais des limites apparaissent clairement : - sur la dispersion des institutions chargées se prendre des décisions - tient à des institutions qui ne peuvent pas prendre de mesures contraignantes - l'apparition d'un courant climato-sceptique (USA, Australie)