Chargement dans le
Google Play
Mouvements et interactions
Constitution et transformations de la matière
Propriétés physico-chimiques
Les circuits électriques
Énergie : conversions et transferts
Les états de la matière
Structure de la matière
Vision et image
L'organisation de la matière dans l'univers
Les signaux
Lumière, images et couleurs
Ondes et signaux
Les transformations chimiques
Constitution et transformation de la matière
L'énergie
Affiche tous les sujets
Le xviiième siècle
Le monde depuis 1945
Le nouveau monde
Les religions du vième au xvème siècle
Une nouvelle guerre mondiale
La crise et la montée des régimes totalitaires
Les guerres mondiales
La guerre froide
La france et la république
Nouveaux enjeux et acteurs après la guerre froide
La méditerranée de l'antiquité au moyen-age
Le monde de l'antiquité
Le xixème siècle
La 3ème république
Révolution et restauration
Affiche tous les sujets
La génétique
Le mouvement
Le monde microbien et la santé
La géologie
Corps humain et santé
Reproduction et comportements sexuels responsables
Procréation et sexualité humaine
Diversité et stabilité génétique des êtres vivants
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
Nutrition et organisation des animaux
Nourrir l'humanité : vers une agriculture durable pour l'humanité ?
La cellule unité du vivant
Unité et diversité des êtres vivants
La planète terre, l'environnement et l'action humaine
Affiche tous les sujets
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
La coordination par le marché
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
La croissance économique
Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire ?
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment s'organise la vie politique ?
La monnaie et le financement
Vote et opinion publique
Les sociétés developpées
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Affiche tous les sujets
08/01/2023
1606
86
Partager
Enregistrer
Télécharger






I. Introduction Un conflit (du latin conflictus "choc") est une situation de rivalité entre au moins 2 protagonistes ou deux Etats. Il existe une grande variété de conflits, la forme la plus grave étant la guerre. Faire la guerre, faire la paix La guerre est le type de conflit le plus grave car c'est un affrontement armé entre au moins 2 entités organisées à travers des forces militaires (armées, milices ...) dans lequel il y a un usage des armes et de la violence pour blesser et tuer. Pour Carl von Clausewitz c'est "un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté" ● D'après l'ONU il existe 3 types de guerres: ● La guerre interétatique ou la guerre entre les Etats ● La guerre intraétatique ou la guerre civile La guerre asymétrique ou non-conventionnelle ou irrégulière qui oppose un Etat à un acteur non-étatique et non-conventionnel La paix, au contraire, désigne une situation dans laquelle les Etats ne sont pas en guerre. Répartition des guerres dans le monde aujourd'hui: Il existe une vingtaine de guerres dans le monde: ● 60% en Afrique sub-saharienne, où l'on trouve les 3 types de guerre: O Interétatique: Soudan et soudan du Sud O Intraétatique: République Démocraitque du Congo O Asymétrique: Nigeria vs. Boko Haram 25% au Moyen-Orient: Afghanistan, Irak et Syrie (les...
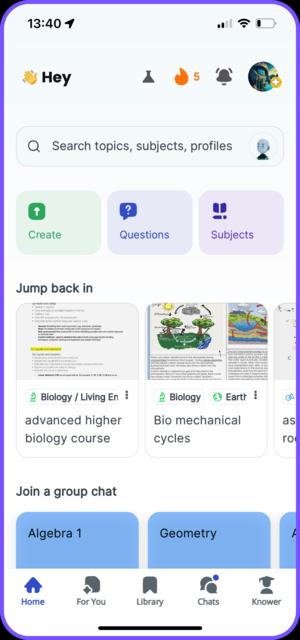

Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
Lola, utilisatrice iOS
3 types de guerre), Yémen Les 15% restants se répartissent entre l'Asie (ex: rébellions ethniques aux Philippines), l'Amérique latine (ex: guerre civile au Mexique, états vs. cartels) et l'Europe (ex: l'Ukraine et la Russie) Différentes caractéristiques: Facteurs et enjeux à l'origine du développement de la guerre: O prise de contrôle d'un territoire (ex: région du Sahel) o prise de contrôle des ressources naturelles ou énergétiques O remise en cause des frontières o religion (ex: hindoux vs. musulmans au Cachemire) O Volonté séparatiste ou indépendantiste (décolonisation, ETA, IRA) ● Acteurs: Etats, armées, milices, groupes terroristes, civils, ONG ● Cibles: lieux stratégiques (villes, espaces industriels et portuaires) et populations (groupes ethniques [génocides], civils) ● Durée: de quelques jours (ex: guerre de 6 jours en 1967) à plusieurs années (ex: conflits israélo-palestinien depuis 1948) Différentes manières de mettre fin à la guerre et revenir à la paix: ● paix positive: situation entre deux états caractérisée par la reconnaissance mutuelle, la sécurité collective, la coopération et la résolution non-violente des conflits • paix négative: absence de conflits mais de fortes tensions entre les acteurs → Différentes manières pour y parvenir: négociation, médiation, arbitrage, traité de paix ou conférences internationales La dimension politique de la guerre A. "La guerre, continuation de la politique par d'autres moyens" La guerre à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) Moyen-Age: roi ne maîtrise pas totalement la puissance militaire (dépendant de l'élite politique) → Fin Moyen-Age et Renaissance: construction d'Etats modernes, armées permanentes, obéissant directement au roi, servent à la politique extérieure et à la sécurité II. Le poids de la politique dans la guerre à l'époque moderne → Selon Clausewitz dans De la guerre, la force pure n'est pas le seule élément à prendre en compte dans le déclenchement d'une guerre: différence entre guerre absolue (but: anéantir l'adversaire en usant tous les moyens) et guerre limitée (proportionnée au moyens disponibles) → A cette époque, les souverains préfèrent négocier pour faire valoir leurs intérêts : indemnités de guerres, territoires conquis pas de destruction totale. La guerre de 7 ans selon Clausewitz (1756-1763) → La Guerre de 7 ans représente l'illustration de ses théories: alliances en fonction des intérêts politiques, pas une guerre totale, mais une guerre pour défendre ses intérêts personnels ➡ La guerre de 7 ans est une guerre interétatique 2 camps: O La Grande Bretagne, la Prusse et la Portugal ● ● O La France, l'Espagne, l'Autriche et la Russie Des champs de bataille dans le monde entier: Europe (ex: bataille de Rossbach), Amérique du Nord (ex: Cuba, Martinique), Inde (ex: Pondichéry), Afrique occidentale (ex: Saint-Louis-du-Sénégal) → Bilan: 1er conflit d'ampleur mondiale: bilan humain très élevé (700 000 militaires tués, et 500 à 800 000 civils), bilan territorial (Gains pour la Grande Bretagne [ex: Louisiane et Canada], pertes pour la France et l'Espagne, mais la France garde certains territoires [ex: Sénégal]), diplomatique (affirmation de la puissance de la Grande Bretagne et de la Prusse, recul de la puissance de l'Autriche, de la France et de l'Espagne). B. Des guerres de nations, aux guerres révolutionnaires à la Seconde Guerre Mondiale Apparition des armées nationales (guerres révolutionnaires + napoléoniennes) → Pour Clausewitz, ces guerres marquent un tournant dans les guerres: fin du modèle aristocratique, victoire des idéaux (défense des idées de la révolution), grandes armées (armée de Napoléon: + de 1 650 000 soldats). Nouvelles formes de guerre: vers la guerre absolue (+ coûteuse, + violente et + longue) Clausewitz souligne aussi un très grand nombre d'insurrections (ex: 1808, Espagne) → Pour David Belle: ces guerres ne sont plus strictement politiques car la révolution donne à la guerre un visage populaire ("La Nation en armes"), recrutement de grands armées (guerre de masse), armées + autonomes (mêlent plusieurs corps) → Mais il ne faut pas surévaluer ces mutations: les stratèges continuent à suivre les anciennes théories militaires, évolution de l'armement limitée, baisse de l'ardeur au combat des citoyens-soldats ● Au XIXe siècle, la guerre change et s'industrialise (changement d'échelle) → + de combattants (ex: Rossbach en 1755: 75 000 soldats # Verdun en 1916: 1,2 millions de soldats) → + de morts (de 1805 à 1855: 3 millions de morts dans les guerres, 1ère Guerre Mondiale: 12 millions de morts) → Augmentation de la puissance d'armement (gaz, chars, avions), guerre totale (les populations civiles sont touchées) Guerres de masses et guerres totales: les 2 Guerres Mondiales → 1ère Guerre Mondiale: défense de l'Etat-Nation comme objectif suprême → 2ème Guerre Mondiale: dimension idéologique, attaquer les civils (briser l'ennemi) C. Depuis 1945, l'émergence de nouvelles formes de guerres La Guerre froide [1947-1991]: "paix est impossible, mais guerre directe est improbable" (citation de Raymond Aron) → Hausse des tensions et guerres civiles (ex: Grèce), interventions indirectes (ex: Afghanistan [1979-1989]: les USA interviennent pour affaiblir les soviétiques) → Le nucléaire n'empêche pas les affrontements: guerres révolutionnaires ou guerres d'indépendance → Plus de guerres dès 1991 (entre 2001 et 2017, seuls 4 des 73 conflits sont interétatiques): Renouveau des guerres civiles (ex: depuis 2011: en Libye) ● Guerres asymétriques: acteurs puissants conventionnels (utilisation de cyberguerres, technologies, partisans du 0 morts) # acteurs moins puissants (combattants peu nombreux, mal équipés, organisations indifférentes à la mort de leurs combattants) Le terrorisme international promeut la notion de "guerre irréguliere" → Guerre sans front ni frontières, les Etats ne sont plus les seuls acteurs engagés (mercenaires, terroristes etc.) Plus de respect du droit de la guerre → Développement de zones grises: guerilla (ex: drogue en Colombie), mafieux, maritimes (ex: pirates en Somalie), terroristes (ex: IRA, groupes armés palestiniens) ➡ Mode d'action qui dépasse le cadre traditionnel de la guerre mais la violence reste utilisée dans un but politique III. Le défi de la construction de la paix A. La paix par les traités: la paix de Westphalie (1648) La guerre de 30 ans: origine du nouvel ordre Westphalien: → Conflit politique et religieux: princes protestants refusent l'unification avec les Habsbourg d'Autriche (famille catholique) → Conflit qui s'étend sur tout le continent: Grande Bretagne, France, Danemark, Provinces-Unies → Guerre violente et destructrice ➡ Traités de Westphalie marquent un tournant décisif dans l'histoire de la diplomatie mondiale (24 octobre): conférence internationale avec des plénipotentiaires (les souverains ne sont pas sur place), pas de puissance hégémonique, professionnalisation de la diplomatie (mais il faut quand même 3 ans pour signer les traités ➡ Rupture dans l'histoire des relations internationales sur le court terme: ● Recul des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne → perte de territoires et développement des sentiments nationalistes ● Satisfactions territoriales (ex: France et Suède) Reconnaissance d'Etats autonomes (ex: Provinces Unies) ● Fin des guerres de religion ➡ Rupture dans l'histoire des relations internationales sur le long terme: Nouvel équilibre des puissances basé sur la souveraineté des Etats, le droit international et la coopération pour stabiliser la scène internationale B. Faire la paix entre le XVII et le XXe siècle: différentes tentatives Difficultés dans l'après guerre: tenir compte de tous les belligérants, même les perdants → Ce sont les armées qui assurent l'ordre et la paix Des guerres sans traité de paix ● ex: Fin de la 2ème guerre mondiale, pas de traité de paix avec l'Allemagne nazie ex: Corée, conflits toujours en cours (armistice: 1953) La Société des Nations [SDN]: première présence d'une institution internationale (crée en 1919 avec le traité de Versailles) et vise à établir la paix de façon multilatérale, régler les problèmes par la démocratie (= espoir) → Mais la SDN présente des limites: • Les pays vaincus ne sont pas invités ● Les Etats-Unis ne font pas partie de la SDN ● Pas d'armée ⇒ La SDN est impuissante face à la montée des totalitarismes C. Faire la paix par la sécurité collective: l'ONU de Kofi Annan (1997 à 2000) L'ONU: principale organisation de maintien de la paix (créé le 26 juin 1945, au début, l'ONU comptait 50 Etats membres → aujourd'hui elle en compte 193) → Durant la guerre froide, l'ONU était impuissance à cause du droit de véto Depuis 1991: Elle a une place de plus en plus importante et oeuvre notamment à la paix → La politique de Kofi Annan, entre succès et limites → Politique diplomatique: promouvoir la responsabilité de protéger, développement des négociations et de la diplomatie préventive ● Succès: en 2000: négociations qui aboutissent à la fin de la guerre au Sud-Liban, 2001: intervention en Afghanistan Limites: pas d'instauration du devoir d'ingérence, budget trop faible → Politique économique et sociale: lutter contre les inégalités + liberté de la presse ● Succès: Création des 8 objectifs pour le millénaire pour le développement, 2006: soutien à Cartooning for Peace ● Limites: loin d'atteindre les 17 objectifs de développement durables sur 15 ans voire 35 ans L'ONU reste coincée entre intérêts des grandes puissances et manques de négociateurs: → Droit de véto utilisé pour éviter le règlement de conflits (ex: USA dans le conflit israélo-palestinien, Russie dans la guerre en Syrie) → Etats qui mènent leur propre politique sans respecter les décisions de l'ONU (ex: USA qui quitte les accords de la COP21 [2019] et l'OMS [2020], invasion de la Crimée [2014] → Absence d'interlocuteurs pour mettre fin aux combats (interlocuteurs qui refusent de discuter [ex: terroristes], acteurs aux intérêts divergents [ex: Syrie] IV. Le Moyen-Orient: Conflits régionaux et tentatives de paix A. Région stratégique qui attise les convoitises mondiales Berceau de 3 grandes religions monothéistes: • Peuples majeurs: arabes (250M), Turcs (30M), Perses (80M), mais aussi kurdes (victimes de persécutions) et juifs et chrétiens (discriminations) Les sunnites sont majoritaires (80 à 90%) mais les chiites sont aussi présents notamment en Iran et Irak ● Lieux saints à forte symbolique: Jérusalem et la Mecque Enjeu géopolitique Une region au coeur des échanges mondiaux et des rivalités internationales: Espace stratégique: carrefour entre la Méditerranée et l'Océan Indien O passages stratégiques: Suez, Bab-el-Mandeb, Ormuz Espace très convoité durant la guerre froide: → D'abord par les Européens qui se heurtent aux sentiments nationalistes → 1956: Nasser nationalise le canal: crise de Suez, efface les puissances européennes → Puis les USA et l'URSS: O USA: protection d'Israël, pacte de Quincy (protection militaire de l'Arabie Saoudite en échange d'un accès au pétrole O URSS: affrontement par états interposés, conflits israélo-arabes (livraison d'armes) → Puis puissances locales: Panarabisme (mouvement visant à l'unification du peuple arabe, 1967 fin à cause de la guerre des 6 jours + islamisme La question des ressources au Moyen-Orient → l'eau: ressource rare inégalement répartie et disputée → les hydrocarbures: grandes ressources pétrolières mondiales, source de richesses et de convoitises, 1960: OPEP (but: peser davantage sur le cours du pétrole) B. Conflits et tentatives de paix Déclaration de Balfour (1971) soutient le projet sionniste de construction d'un Etat juif en Palestine → 14 mai 1948: Ben Gourion proclame la naissance d'Israël sans tenir compte du plan de partage de l'ONU → Israël: Etat riche avec une armée moderne soutenue par les Etats-Unis → Conflits aux incidences mondiales: crise éco de 1973 (suite à un embargo de l'OPEP, exacerbe encore + les tensions régionales) Les conflits israëlo-palestiniens: entre terrorisme et guerre des pierres → Création d'Israël entraîne l'exode de 700 000 palestiniens vers Gaza, la Cisjordanie et l'Egypte → Les palestiniens s'organisent avec Yasser Arafat (1964, création de l'OLP→ guerre asymétrique) → 1987-1993: guerre civile d'un nouveau genre: l'intifada La paix est impossible à trouver: 2 phases 1948-1970: négociations à l'ONU → paix négative ● seule la résolution 242 sert de base à l'éventuel règlement du conflit ● échec car l'ONU tient au respect de la souveraineté des Etats + faiblesse de la sécurité collective → Dès 1973: négociations bilatérales menées par les USA ● 1979: accords de Camp David entre Israël et la Palestine ● 1993: accords d'Oslo entre Israël et l'OLP → Plus efficaces mais pas de résolution du conflit car extrémistes (ultra nationalistes israéliens + Hamas) Depuis 2000: processus de paix bloqué, montée des tensions Israël: assassinat de Yitzhak Rabin (1995), premier ministre: Benyamin Natanyahou, moins favorable au dialogue, poursuite de la colonisation, construction du mur (2002) ● Palestine: seconde intifada (2000-2005), attentats suicides, le Hamas contrôle Gaza (2006) C. Les deux guerres du Golfe (1991-2003) La guerre du Golfe (1990-1991), une guerre réelle → août 1990: invasion du Koweit par le dictateur Irakien (agrandir les territoires, réserves pétrolières, devenir leader du monde arabe) →George Bush riposte en prenant la tête d'une coalition internationale (=montre la puissance militaire = la capacité des USA à devenir les gendarmes du monde) → début 1991: opération Desert Storm: bombardements aériens et combats terrestres → retrait du Koweït → Guerre réelle tendant aux extrêmes (destruction d'armée et d'infrastructures), mais limitée (Hussein n'est pas renversé) La guerre en Irak (2003), une guerre absolue → Suite aux attentats de 2001, George W. Bush accuse à tort Saddam Hussein de soutenir le terrorisme international et de produire des armes de destruction massive → Intervention unilatérale: les USA écrasent l'armée irakienne et instaurent une démocratie libérale, arrestation de Saddam Hussein ➡ Irak plonge dans une guerre civile: attentats contre l'occupant, montée du terrorisme, influence grandissante de l'Iran, violences entre sunnites et chiites Jusqu'en 2011, les USA restent en Irak (5000 soldats morts, 740 milliards de dollars dépensés) → L'Irak reste un pays meurtri, instable et divisé Le Moyen-Orient depuis les printemps arabes (2001) → Soulèvements de la population contre les dictateurs au pouvoir (Tunisie, Egypte,, Libye), guerre civile en Syrie → 2014-2015: le chaos en Syrie s'étend à l'Irak: Daech en profite pour mener une guérilla terroriste et construire un califat islamique → Symbolise l'incapacité de la communauté internationale à agir efficacement afin de garantir la paix dans la région