Chargement dans le
Google Play
Mouvements et interactions
Constitution et transformations de la matière
Propriétés physico-chimiques
Les circuits électriques
Énergie : conversions et transferts
L'organisation de la matière dans l'univers
Les états de la matière
Structure de la matière
Vision et image
Les signaux
Lumière, images et couleurs
Ondes et signaux
Les transformations chimiques
Constitution et transformation de la matière
L'énergie
Affiche tous les sujets
Le monde depuis 1945
Le xviiième siècle
Le xixème siècle
La guerre froide
Nouveaux enjeux et acteurs après la guerre froide
La méditerranée de l'antiquité au moyen-age
Le nouveau monde
Les religions du vième au xvème siècle
Une nouvelle guerre mondiale
La crise et la montée des régimes totalitaires
Les guerres mondiales
La france et la république
Le monde de l'antiquité
La 3ème république
Révolution et restauration
Affiche tous les sujets
Le mouvement
La génétique
Reproduction et comportements sexuels responsables
Diversité et stabilité génétique des êtres vivants
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique
La cellule unité du vivant
Le monde microbien et la santé
La géologie
Corps humain et santé
Unité et diversité des êtres vivants
Procréation et sexualité humaine
Nutrition et organisation des animaux
Nourrir l'humanité : vers une agriculture durable pour l'humanité ?
La planète terre, l'environnement et l'action humaine
Affiche tous les sujets
Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils et travaillent-ils ?
Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
La coordination par le marché
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ?
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?
Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on ?
La croissance économique
Quelles relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire ?
Comment se forment les prix sur un marché ?
Comment s'organise la vie politique ?
La monnaie et le financement
Vote et opinion publique
Les sociétés developpées
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
Affiche tous les sujets
05/03/2023
496
13
Partager
Enregistrer
Télécharger









Chapitre 2 : Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? Résumé : Le développement des échanges et l'interdépendance croissante des économies caractérisent le processus de mondialisation. Le commerce international se justifie par les gains obtenus lors de l'échange : prix plus faible, plus grand diversité. Les fondements du commerce international font l'objet de différentes analyses, dont la théorie des avantages comparatifs et la dotation factorielle. Les sociétés s'internationalisent et favorisent la mondialisation des économies, notamment grâce aux investissements directs à l'étranger (IDE). L'un des enjeux majeurs de cette concurrence internationale est donc de développer une position compétitive. Introduction : Selon le courant de pensée des économistes classiques (ou libéraux) comme Adam Smith ou David Ricardo, le commerce international permet des gains à l'échange. Il s'oppose au courant mercantiliste (1450 à 1750) qui pense que l'activité économique est liée à l'accumulation de métaux précieux. Les échanges internationaux correspondent donc à un jeu à somme nulle. Des mesures protectionnistes sont alors insaturées comme les droits de douanes. Le commerce internationale introduit le processus de mondialisation. Nous allons donc approfondir la notion de commerce internationale ou libéralisation des échanges en s'intéressant aux avantages et aux spécialisations de ces échanges. Pb : Quels sont les fondements et les effets induits par l'ouverture aux échanges ? -> Qu'est-ce qu'on échange ? -> Internationalisation...
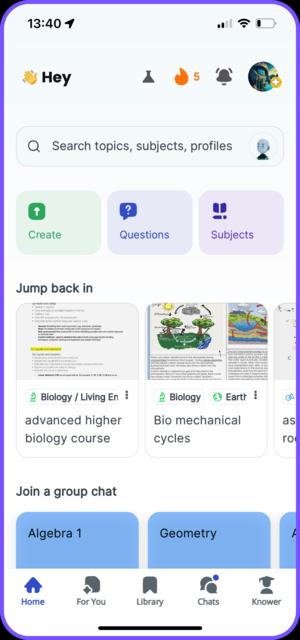

Louis B., utilisateur iOS
Stefan S., utilisateur iOS
Lola, utilisatrice iOS
de la production -> Stratégie des firmes https://www.kartable.fr/ressources/ses/cours/quels-sont-les-fondements-du- commerce-international-et-de-linternationalisation-de-la-production/10598 Amorce au sujet : I/Les caractéristiques des échanges A - L'ouverture croissante des économies 1- L'essor des échanges internationaux L'essor des échanges internationaux dès le XIXème siècle est le résultat d'une ouverture croissante des économies. Internationalisation : L'internationalisation est un processus caractérisant le développement des relations économiques entre les nations. . À partir de 1945, l'internationalisation prend une telle ampleur que la croissance des échanges internationaux est plus rapide que la croissance du PIB. . À partir des années 1960, il est accompagné et accéléré par le développement des firmes multinationales (FMN). Firme multinationale : Une firme multinationale est une plus grande entreprise nationale qui possède ou contrôle plusieurs filiales de production dans plusieurs pays. Elle est composée d'une société-mère (dans le pays d'origine) et d'entreprises détenues ou contrôlées à l'étranger, appelées filiales. 2- La Mondialisation Le développement des échanges s'est accompagné d'une libéralisation des marchés (c'est à dire un abaissement des barrières à l'échange, comme les barrières douanières) ainsi que d'une accélération des échanges de tous types. La nature même des produits échangés a évolué. Cela participe à la mondialisation. Mondialisation : La mondialisation va au delà de l'internationalisation, elle désigne le passage d'un cadre national à un cadre international pour les agents économiques, et une interdépendance croissante entre les acteurs économiques à l'échelle du globe. B - Comment expliquer cet essor ? Plusieurs explications permettent de comprendre l'essor du commerce internationale : . Les progrès technique ont permis une diminution des coût de communication et de transport. . L'ouverture des économies au libre-échange a permis un accroissement des échanges à moindre coût. . Le développement des échanges a été favorisé par l'accroissement du commerce intra-firme. Libre-échange : Le libre-échange est une doctrine économique qui prône la liberté de circulation de tous les biens économiques (produits, services, capitaux, monnaie) entre les pays. Commerce intra-firme : Le commerce intra-firme désigne les échanges entre filiales d'une même FMN ou entre la société-mère et ses filiales. II/ Les fondements du commerce international 1) Des facteurs politiques et techniques propices au développement des échanges a - Des facteurs politiques : les accords de Bretton Woods (1944) Les accords de Bretton Woods ont principalement permis de créer un cadre monétaire et financier stable. De nouvelles institutions firent leurs apparitions comme le FMI (Fonds Monétaire International) ou la Banque de France afin de ne plus revivre la crise de 1929. A ce moment, le dollar devient rattaché à l'or. En 1947, les accords général sur les tarifs douaniers et le commerce notamment appelés GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) deviennent à présent I'OMC = Organisation Mondiale du Commerce. Cette nouvelle organisation favorise le libre échange. Elle instaure les Accords de libre échange dans certaines régions comme pour l'Union Européenne. b - Des facteurs techniques SYSTEME DE LIBRE-ÉCHANGE € PRODUCTION D'UN Nous faisons à présent face à des révolutions techniques. Les Nouvelles Technologies de I'Information et de la Communication (NTIC) permettent l'essor des FMN (Firmes Multi Nationales). Les Investissements Direct à l'Etranger (IDE) vont être également valorisés. Nous en parlerons d'avantage dans le contexte de l'internationalisation. 2) Une spécialisation basée sur l'avantage comparatif et les dotations factorielles a-La théorie des avantages absolus d'Adam Smith Adam Smith est un philosophe et économiste du 18ème siècle. Il publie << Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776. La théorie mie en avant par Adam Smith est celle de l'avantage absolu. Certains pays ont des avantages que d'autres n'ont pas et donc << tant que l'un des pays aura ces avantages et qu'ils manqueront à l'autre, il sera toujours plus avantageux pour celui-ci d'acheter au premier, que de le fabriquer lui même »>. L'ouverture aux échanges permet d'avoir des gains et de tirer le meilleur parti des gains de productivité. Chaque pays détiendront donc un avantage absolu sur le bien ou le service. Cette avantage absolu se fait après avoir analyser les coûts de production pour le bien en question. Par conséquent, selon Adam Smith, chaque pays aurait intérêt à se spécialiser dans la production du bien qui lui coute le moins cher. b - La théorie de l'avantage comparatif Selon la théorie des avantages comparatifs, peu importe si un pays a des avantages absolus ou pas : il gagne à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels son avantage comparatif est le plus élevé, c'est-à-dire dont les coûts relatifs sont les plus bas, et à échanger les biens qu'il ne produit pas. Un pays a donc intérêt à se spécialiser dans la production du bien où il est relativement le plus productif. La théorie des avantages comparatifs nous enseigne donc que l'échange est mutuellement avantageux même dans le cas où l'un des deux pays est plus productif que l'autre dans toutes les branches. Ces gains mutuelles sont le produit de la spécialisation rendue possible à l'échange qui permet à chaque pays d'allouer plus efficacement ses facteurs de production. c - Spécialisations et dotations factorielles Le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson est une théorie du commerce international qui explique le commerce international par les différences de dotations en facteurs de production des pays qui y participent. Il porte le nom de Bertil Ohlin, Eli Heckscher et Paul Samuelson, qui ont chacun participé à sa création. Selon le théorème HOS, chaque pays doit se spécialiser dans la production et l'exportation du bien dont la production utilise de façon intensive le facteur qui est relativement plus abondant dans le pays. Il doit importer le bien dont la production est intensive dans le facteur relativement rare. Travail * Capital Allemagne Tee-shirts Voitures Bangladesh Tee-shirts Echanges sur le marché internationa Travail * Résumé de la spécialisation basée sur les avantages comparatifs et les dotations factorielles : Selon les économistes classiques Adam Smith (1723-1790) et David Ricardo (1772-1823), un pays doit se spécialiser dans une seule production et échanger avec les autres pays tout ce qu'il ne produit pas. Dès lors, comment faire ce choix de spécialisation ? Dans Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), Adam Smith propose la théorie des avantages absolus selon laquelle un pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il est le meilleur et importer le reste en provenance des autres pays. David Ricardo complète et prolonge les analyses de Smith avec sa théorie des avantages comparatifs : selon lui, un pays doit non seulement se spécialiser dans la production pour laquelle il est meilleur que les autres, mais aussi, à défaut, dans celle où il est le moins mauvais. Ricardo démontre en effet qu'avec une spécialisation dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage comparatif, chaque pays a un intérêt à échanger avec les autres. Tous les pays participant au commerce international sont ainsi gagnants : il s'agit d'un jeu à somme positive. Ricardo n'explique pas d'où vient cet avantage comparatif. Pourquoi un pays est-il meilleur qu'un autre pour produire tel ou tel bien ? Trois auteurs ont répondu à cette question : Eli Heckscher (1879-1952), Bertil Ohlin (1899-1979) et Paul Anthony Samuelson (1915-2009). Selon eux, l'explication réside dans la dotation factorielle du pays, c'est-à-dire la quantité de facteurs de production (capital et travail) dont le pays dispose. Ainsi, pour être performant, un pays doit se spécialiser dans la production du bien qui nécessite l'utilisation du facteur de production dont il dispose en plus grande quantité relative sur son territoire. Plus récemment, Michael Posner (1931-2006) a ajouté une nouvelle explication à l'avantage comparatif : la dotation technologique. Selon Posner, l'avantage comparatif ne dépend pas uniquement des dotations factorielles << naturelles », mais aussi des capacités d'innovation et de la propension à lancer de nouveaux produits. Un pays disposant de ce dynamisme technologique, comme les États- Unis, doit se spécialiser dans un type de production innovante. 3) L'échange international entre pays comparables Objectif d'apprentissage: Comprendre le commerce entre pays comparable : Différenciation et qualité des produits, Fragmentation de la chaîne de valeur a - Les échanges intra-branches : le rôle de la différenciation et de la qualité des produits En 1980, Paul Krugman, dans son oeuvre << nouvelle théorie du commerce international », explique le développement du commerce international entre nations comparables : le commerce intra-branche. On s'éloigne du modèle HOS issu d'une concurrence pure et parfaite. Dans ce nouveau modèle, le marché est imparfaitement concurrentiel vu les différenciations des produits. Une partie importante du Cl contemporain est réalisé entre pays comparables (échange entre pays développés = 40% du Cl) et concerne des produits similaires (commerce intra-branche = 30 % du CI). Les théories traditionnelles du Cl sont incapables d'expliquer ces types d'échanges • Pour les expliquer, il faut partir du constat que les firmes mettent en œuvre des stratégies de différenciation des produits différenciation horizontale (même niveau de qualité que les concurrents mais des caractéristiques qui diffèrent) ou verticale (des niveaux de gamme, soit de qualité, qui diffèrent). • La différenciation horizontale des produits génère des flux commerciaux entre pays comparables parce que les consommateurs nationaux peuvent trouver ailleurs des produits présentant des caractéristiques plus en accord avec leurs préférences et ainsi accroître leur satisfaction. • La différenciation verticale des produits génère des flux commerciaux entre pays comparables parce que les consommateurs ont des attentes en termes de qualité qui diffèrent (cas du commerce manufacturier entre la France et l'Allemagne). • Le commerce intra-branche ne se limite pas aux biens finals; il concerne également les biens intermédiaires. Le poids du commerce intra-branche dans le Cl de biens intermédiaires est en forte croissance depuis les années 1970 parce que les firmes ont procédé à une fragmentation internationale de leurs chaînes de valeur. Définition du commerce intra-branche: Flux simultanés d'exportations et d'importations de marchandises appartenant à la même branche d'activité. # inter-branches = expliqué par les théories du Cl III / Les déterminants de la compétitivité Pour approfondir la notion : https://www.sciencespo.fr/department-economics/econofides/terminale-ses/text/ 02.html#23-quels-sont-les-déterminants-de-la-compétitivité 1) Le commerce international La mondialisation peut être définie comme l'intégration croissante des marchés des biens et services et des marchés de capitaux au niveau mondial. Elle se traduit notamment par une augmentation du commerce international. L'accroissement des échanges découle des stratégies que les entreprises mettent en place pour gagner en compétitivité et des politiques d'ouverture au commerce mises en œuvre par les pouvoirs publics. La compétitivité d'une entreprise désigne la capacité à préserver et à gagner des parts de marché. Les entreprises adoptent des stratégies pour renforcer leur compétitivité. 2) La compétitivité-prix Pour gagner des parts de marché, les entreprises peuvent chercher à diminuer le prix de vente des biens et services vendus. En effet, la concurrence entraînant une guerre des prix, les entreprises doivent aligner leurs prix de vente sur ceux de leurs concurrents pour ne pas voir le volume de leurs ventes décliner. Cette baisse des prix entraîne une baisse des profits et peut même causer des pertes quand les prix deviennent trop bas. Pour éviter une baisse trop forte de leur taux de marge du fait de cette baisse des prix, les entreprises vont chercher à réduire leur coût de production en adoptant des méthodes de production plus efficaces (gains de productivité) et/ou en se localisant dans des zones géographiques où les facteurs de production sont moins onéreux (notamment là où le coût de travail est plus faible) et où la fiscalité est plus faible. Cette recherche de compétitivité-prix peut ainsi entraîner des délocalisations. Ex.: Des entreprises françaises vont installer des unités de production en Chine pour bénéficier de coûts de production moins onéreux. 3) La compétitivité hors prix Les entreprises peuvent également chercher à différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents pour séduire les consommateurs. En proposant des produits de meilleure qualité ou ayant des caractéristiques différentes, elles restent ainsi compétitives tout en pratiquant des prix plus élevées que leurs concurrents. Les gains en terme de compétitivité hors prix peuvent aussi découler d'une proximité plus grande de la clientèle permettant une plus grande réactivité des entreprises (réduction des délais de livraison) ou d'un meilleur service après-vente. Les lieux de production peuvent, dans cette optique, se rapprocher des lieux de consommations mais il peut aussi s'agir tout simplement de mieux former les vendeurs pour qu'ils puissent mieux conseiller leurs clients en fonction de ce qu'ils recherchent. Ex.: L'entreprise Wisecom a fait le choix d'installer des centres d'appel en région parisienne pour être au plus près du client et améliorer la relation client. Concurrence et compétitivité Concurrence Nécessité pour les entreprises d'être compétitives Compétitivité - prix •Il faut être plus efficace *Diminuer les coûts •Stratégie de délocalisation pour certaines entreprises Compétitivité hors - prix *Qualité •Services Innovation Image de marque IV / Le débat opposant libre-échange et protectionnisme En bref : Bien que de nombreuses théories préconisent le développement du commerce extérieur, une contestation croissante de la mondialisation semble en nuancer les avantages. Ce débat oppose les partisans du libre-échange à ceux du protectionnisme. Le libre échange A - Les avantages du libre-échange . Le libre échange augmente les profits des producteurs. Leur spécialisation et les économies d'échelles stimulent leur productivité et leurs profits. . Il augmente la satisfaction des consommateurs en leur offrant une plus grande variété de produits à des prix moins élevées. . Il peut contribuer à réduire les inégalités entre les pays. En s'intégrant au commerce mondial, la Chine a réduit l'écart de niveau de vie qui la séparait des pays riches. B - Les risques du libre-échange . Les entreprises moins compétitives font faillites, au détriment de l'emploi local. . (Comme le regretté A. Gutteres, Secrétaire général des Nations Unis,) Le libre échange augmente les inégalités au seins de chaque pays. Les travailleurs les plus qualifiés et les capitaux peuvent s'offrir aux pays les plus rémunérateurs ; les travailleurs les moins qualifiés doivent accepter des rémunération locales faibles. . Toute spécialisation n'est pas nécessairement avantageuse : si un pays produit un bien dont la valeur baisse sur les marchés internationaux, sa production en volume augmente, mais ses revenus chutent. 2) Le protectionnisme A - Les avantages du protectionnisme . Le protectionnisme désigne les mesures visant à protéger la production nationale contre la concurrence étrangère, notamment pour protéger l'emploi ou certains secteurs d'activité comme comme l'agriculture. Il peut se manifester par une hausse du prix des importations (droits de douane, subventions aux producteurs locaux, baisse du taux de change) ou par des limites (quotas, normes techniques et sanitaires, ...). . Le protectionnisme peut également chercher à protéger des activités jugées d'intérêt national (agriculture au nom de l'indépendance alimentaire, ...) ou encore être brandi comme recours contre des pratiques étrangères jugées déloyales (dumping, socio-fiscal ou environnemental). B- Les risques du protectionnisme . Le protectionnisme limite la concurrence et n'incite donc pas à innover et gagner en productivité ; il en résulte un maintien des prix à un niveau élevé. . Il peut entraîner des représailles des pays étrangers. En réponse au relèvement des droits de douanes américains sur ses produits (passés de 3,1 à 21,8% entre mars 2018 et septembre 2019 à la demande du président D. Trump), la Chine a relevé ceux qu'elle applique à ses importations de produits américains (de 8 à 21,8%). . Le recours au protectionnisme peut être inégalitaire : les subventions de l'Union européenne permettent à ses agriculteurs de rivaliser avec des produits d'Amérique du Sud qui seraient plus compétitif sinon.